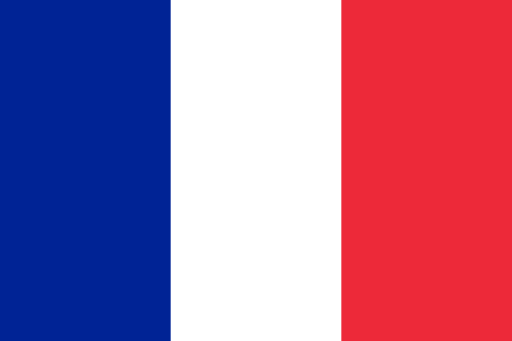L’épuration des acteurs du marché de l’art à la Libération
L’épuration fut un « parcours accidenté1 » mais non « sauvage2 » : de l’ordonnance du 18 août 1943 instituant à Alger une commission d’épuration à la loi d’amnistie générale du 6 août 1953, des dizaines de textes façonnent le processus transitionnel.
L’objectif est de rétablir la légalité républicaine et d’apporter un panel de sanctions proportionnées aux accusations, sans mettre en péril l’unité de la nation, la stabilité politique et économique. D’Alger, le message gaullien est clair : il faut préparer la Libération, « restaurer la justice d’État et livrer à ses équitables jugements ceux qui ont trahi la patrie3 ».
C’est à partir du printemps 1944, alors que la vengeance violente est en essor, que le Gouvernement provisoire de la République française densifie le cadre judiciaire et administratif en créant plusieurs cours et comités par ordonnance : les cours de justice le 26 juin 1944 ; les chambres civiques le 28 août ; les comités départementaux de confiscation des profits illicites ainsi que les comités régionaux interprofessionnels d’épuration et la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration le 18 octobre ; enfin la Haute Cour de justice le 18 novembre.
Les manifestations extra-légales n’ont alors pas cessé4 mais l’utilisation de la justice militaire a permis d’offrir une réponse juridictionnelle temporaire à la vindicte populaire, une justice imparfaite mais immédiatement opératoire5.
En marge de ces grandes ordonnances, une multitude de commissions spécialisées sont créées afin d’épurer chaque corps de l’État et de l’administration, chaque secteur professionnel, intellectuel ou artistique.
C’est donc tout un cadre judiciaire d’épuration qui est mis en place (I), mais c’est surtout par le prisme économique qu’a été traité le cas des acteurs du marché de l’art (II).
Le volet pénal : cours de justice, chambres civiques, Haute Cour
Pour condamner des individus, il faut établir une culpabilité par rapport à des faits prévus et punis par la loi applicable au moment de leur commission. La souveraineté, absolue, indivisible et perpétuelle est incarnée à la Libération par le peuple français et représentée par un gouvernement qui s’affiche comme légitime depuis 1940 et de retour d’exil.
Toutefois, le corps de droit commun peut ne pas correspondre aux volontés d’épuration d’une période d’après-guerre. La justice transitionnelle est alors tentée d’établir une liste d’incriminations nouvelles intimement liées aux circonstances exceptionnelles.
La trahison, crime de droit commun, pouvait être mobilisée puisque l’appel à cesser le combat du 17 juin 1940 fut interprété comme la matrice de toutes les trahisons à venir. À partir du moment où le régime de Pétain est considéré comme une usurpation de souveraineté, en lien avec une occupation par une puissance étrangère, toute participation audit régime est un signe d’intelligence avec l’ennemi en temps de guerre, passible de la peine de mort (article 75 et suivants du code pénal). L’atteinte à la sûreté de l’État peut aussi être retenue et entraîner une peine de travaux forcés (article 79 et suivants).
Le jugement des hauts responsables politiques ne pose guère de problèmes juridiques puisque le gouvernement s’appuie sur une longue tradition de hautes cours politiques. Mais au-delà de la centaine d’individus jugés par la Haute Cour, ce sont plus de 55 000 accusés de trahison qui comparaissent devant les cours de justice mises en place sur l’ensemble du territoire1.
Néanmoins, la trahison constitue un crime trop grave et monolithique pour espérer traduire l’éventail des comportements durant l’Occupation. Un modeste fonctionnaire qui, au détour d’une conversation, exprime son indifférence au sort des Anglais ou des résistants, ne peut être jugé au même titre qu’un milicien ou un dénonciateur zélé.
Ainsi est-il créé le crime d’indignité nationale dont la couleur moralisante permet d’atteindre le for intérieur de chaque individu autant que sa place dans la communauté des citoyens. Ce « châtiment républicain2 » sonne comme un rappel aux fondements antiques de la Cité. C’est la création de l’idée du « vichyste », qui s’est extrait du corps de la République par ses actions et paroles, donc par ses pensées. Il doit subir un châtiment infamant dont on trouve trace de manière régulière dans l’histoire du pays depuis la Révolution et la « lèse-nation » qui succède à la lèse-majesté. C’est d’ailleurs par le biais historique que cette incrimination contourne avec difficulté le principe de non-rétroactivité des lois : il ne s’agirait pas d’un crime nouveau mais d’une même infraction sanctionnée par une peine plus douce et donc susceptible de faire l’objet d’une loi pénale rétroactive.
Par cette contorsion juridico-historique, l’ordonnance du 26 août 1944 permet de punir des coupables d’indignité nationale à la peine de dégradation nationale, jugée plus douce au regard des peines du passé telles que la déportation. La dégradation nationale entraîne des privations de droits, déchéances, incapacités et interdictions professionnelles. Elle peut être assortie de confiscation des biens ou d’interdiction de résidence.
Les chambres civiques, instituées auprès des cours de justice, sont principalement compétentes pour établir cette culpabilité d’indignité nationale mais les cours de justice peuvent aussi prononcer, de manière accessoire, des peines de dégradation nationale. Sur 69 282 individus jugés, 46 645 sont condamnés à la dégradation nationale à vie ou à temps3.
Ces chiffres constituent le bout de la chaîne judiciaire car la grande majorité des affaires sont filtrées en amont par les comités de libération puis les institutions rétablies, dans le but d’éviter l’engorgement des tribunaux lié à des dynamiques locales de vengeance plus ou moins fondées.
L’épuration économique et les acteurs du marché de l’art
Le marché de l’art et ses acteurs s’insèrent dans le cadre de l’épuration professionnelle et économique. Cela dit, ce secteur n’a pas été traité en priorité et cela se reflète dans l’historiographie, qui s’est surtout intéressée à l’administration, aux professions juridiques, intellectuelles et financières, tant sur le volet pénal que sur le volet économique.
Les historiens sont peu à peu revenus sur l’idée d’Henry Rousso selon laquelle « la collaboration économique avait été la plus importante et la plus répandue » mais « sa répression plus que modérée1 ».
Inégale mais existante, car cernée par les mêmes injonctions contradictoires de rapidité et de stabilité que l’épuration pénale, l’épuration économique permet de poser la question du profit licite en temps de guerre et de distinguer les enrichissements possibles, de bonne foi ou par la fraude et la collaboration.
En outre, la guerre a frappé l’intégralité du corps social de privations qui ne cessent pas immédiatement à la Libération, rendant plus insupportables les petits et grands profiteurs. Partout se pose la question de la contrainte et du travail pour l’Allemagne. La méfiance populaire touche jusqu’aux rapatriés des travaux forcés.
La collaboration économique peut d’ailleurs être un échelon vers une qualification pénale de collaboration active tombant sous le coup de l’indignité nationale ou de l’intelligence avec l’ennemi. En effet une disposition du code pénal d’avant-guerre, restaurée à la Libération, permettait d’incriminer les échanges économiques avec l’ennemi, non pas sur le seul fondement de leur existence avérée mais en recherchant l’intentionnalité qui a motivé les actes de l’accusé.
Trois organismes principaux sont créés afin de traiter l’épuration économique : les comités départementaux de confiscation des profits illicites (CCPI), les comités régionaux interprofessionnels d’épuration (CRIE), et la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration (CNIE).
Pour les CCPI, institutions composées en majorité de membres de l’administration fiscale, il existe un réel décalage entre le volume d’affaires, la sévérité des sanctions prononcées et la réalité du recouvrement des sommes demandées. L’engorgement pousse à multiplier le nombre des comités et à renvoyer les affaires plus simples au fisc pour redressement. Malgré ces renvois, ce sont plus de 123 000 citations qui sont dénombrées même si la réalité du recouvrement et donc du rendement final est difficile à évaluer. L’octroi fréquent de délais de paiement et la mise en place d’échéanciers interdisent, en l’absence de séries continues d’archives pouvant servir de preuve, de dresser des conclusions définitives2.
Des études locales permettent de comprendre l’attente qui existe autour des CCPI et leurs difficultés. En Gironde, par exemple, le CCPI peine à démarrer son activité du fait de l’absence d’instructions claires et du manque de personnels, en particulier d’experts-comptables3. En outre, le comité doit accorder son action avec celle du CRIE dont l’objectif est de purger les entreprises des éléments individuels compromis sans toucher à l’aspect économique.
Les CRIE, présidés par des magistrats mais composés de manière paritaire par des patrons, des ouvriers et des fonctionnaires, peuvent ainsi prononcer des peines professionnelles, d’interdiction d’exercice, d’exclusion, voire de dégradation nationale afin d’éviter un renvoi devant la chambre civique. Les procédures sont longues et ralenties par les usages du secret professionnel. L’activité ne se concrétise par des sanctions qu’à partir de 1946, lorsque l’urgence épuratoire est déjà passée. Durant ce laps de temps, la presse et l’opinion publique vilipendent ces institutions.
Ces instances d’épuration économique s’intègrent dans une architecture déjà très chargée où de nombreux organismes se croisent, collaborent, voire s’entrechoquent et se superposent. Cette forme de quadrillage épuratoire ne facilite pas la fluidité de la communication des pièces et une même personne peut être poursuivie devant une cour de justice à titre individuel, un CCPI et/ou un CRIE au nom de son entreprise.
Les acteurs du marché de l’art ont été essentiellement présentés et condamnés devant les CCPI et, à quelques exceptions près, les affaires produites devant la CNIE et la cour de justice de la Seine n’ont abouti à aucune condamnation.
À partir de la base RAMA, nous avons retracé 62 parcours individuels marqués par l’épuration et qui ont souvent fait face à plusieurs organismes, en majorité le CCPI et la CNIE.
Une dizaine d’entre eux sont toutefois poursuivis devant la cour de justice pour trois condamnations seulement, celles de Max Stöcklin, Gustav Rochlitz et Yves Perdoux. Stöcklin est un authentique agent de renseignements au service de l’occupant. Ce sont donc ses activités de collaboration plutôt que des achats casuels d’œuvres d’art spoliées qui conduisent à sa condamnation aux travaux forcés à perpétuité pour intelligence avec l’ennemi, le 18 janvier 1946. Rochlitz est, lui, en lien très étroit avec l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) et se présente par trois fois devant le CCPI, avec séquestre général des biens et fortes amendes, tout en étant condamné à trois ans de prison par la cour de justice. Enfin, Yves Perdoux a mené une collaboration économique active avec les autorités allemandes, parfois en lien avec Rochlitz. Il est condamné à une amende et à la dégradation nationale par la cour de justice et est également poursuivi devant le CCPI.
Les autres échappent à une condamnation pour diverses raisons mais leur destin montre les difficultés à faire le lien entre le profit illicite en temps de guerre et la conviction de trahison ou d’intelligence avec l’ennemi.
Le galeriste Alfred Maquet a vu ses affaires rapidement classées en raison d’activités de résistance et du fait de la faiblesse des transactions effectuées avec deux Allemands sans rapport avec des œuvres spoliées. La question de la contrainte et de l’intention pèse aussi dans les décisions regardant la galerie Brosseron, qui a caché et parfois vendu des œuvres de proches juifs à leur demande, ce qui est suffisant pour condamner ses responsables devant le CCPI mais pas devant la cour de justice, au motif que les contacts commerciaux avec les Allemands ont été subis et non recherchés. Il en va de même pour d’autres acteurs impliqués dans des opérations commerciales sans que des faits de collaboration soient clairement établis : la galerie Vandermeersch voit les poursuites devant la CNIE et la cour de justice rapidement abandonnées. Plus net encore, Alfred Maquet a mené très peu d’opérations avec les Allemands et a caché pendant une année un prisonnier de guerre évadé, ce qui a abouti au classement des dossiers ouverts devant la cour de justice et la CNIE.
André Schoeller a connu une fortune aussi contrastée. S’il a été condamné par le CCPI, ses autres dossiers devant la cour de justice et la CNIE sont classés. Son cas relève ainsi de cette ambiguïté envers tous les individus inscrits dans la chaîne économique durant l’Occupation. En tant que membre du Syndicat des négociants en tableaux, il est en relation avec les institutions allemandes tout en maintenant des liens avec des collectionneurs et argue, à la Libération, de faits de résistance. Certains ne sont pas dupes et Jean Dutourd dénonça ces filières franco-allemandes et le fait que « toutes les ventes à l’hôtel Drouot se faisaient sous l’étiquette Schoeller-Fabiani4 ». Martin Fabiani, qui s’est considérablement enrichi durant la guerre, a d’ailleurs connu un sort semblable, avec un classement des affaires pénales mais une condamnation par le CCPI.
L’urgence et le caractère superficiel de certains examens ont pu aussi profiter à certains comme l’antiquaire Paul Tulino, qui ne fut que brièvement inquiété par la cour de justice et la CNIE, alors que des recherches ultérieures ont révélé son implication dans des transactions d’œuvres spoliées. Ces mêmes contraintes de l’appareil d’épuration expliquent peut-être le classement sans suite d’autres dossiers devant la cour de justice, comme celui de la galerie d’Atri impliquée dans plusieurs ventes aux musées allemands et au principal marchand d’art au service de Göring, Walter Hofer. Roger Dequoy a été condamné par deux fois par le CCPI mais bénéficie d’un non-lieu dans le dossier instruit par la cour de justice. Il était en contact avec tout le réseau commercial collaborateur et allemand mais il sut récupérer les collections Wildenstein, dont il avait la charge de la galerie parisienne, évitant ainsi leur confiscation. Le contraire de René Avogli Trotti qui entretint des liens étroits et renouvelés avec Adolf Wüster et des musées allemands, ce qui lui vaut une condamnation devant le CCPI, mais son décès interrompt l’action devant la cour de justice et la CNIE. Paul Pétridès est aussi disculpé devant la cour de justice et la CNIE quoique condamné pour profits illicites5.
Dans notre panel, aucun dossier présenté devant la CNIE n’a abouti à une condamnation. Là encore, la collaboration n’est pas retenue malgré la prise de profits illicites. Marie Albin a connu des soupçons de comptabilité double qui lui valent une condamnation du CCPI, minorée ensuite par le Conseil supérieur de confiscation des profits illicites (CSCPI). Elle a bénéficié du soutien de Michel Martin, rapporteur à la CNIE, qui œuvra autant que possible au maintien des œuvres et objets d’art sur le sol français durant l’Occupation.
D’autres comme Étienne Bignou, Pierre Landry, Édouard Leonardi ou Jean-Louis Souffrice sont condamnés pour profits illicites mais disculpés par la CNIE malgré des liens réguliers et des volumes de transactions importants avec des personnes et institutions allemandes. L’intentionnalité est au cœur de la défense qui se base sur les mêmes arguments : absence de sollicitation des clients allemands, caractère forcé des transactions, ventes effectuées au profit de Juifs dans le besoin, et parfois absence d’appauvrissement du patrimoine national du fait de la vente d’œuvres d’art sans qualité majeure ou bien d’école allemande. Malgré un volume de transactions important touchant des œuvres issues de collections alors considérées comme juives au regard de la législation antisémite, Raphaël Gérard voit son dossier classé par la CNIE autant que par le CCPI, ainsi que la galerie Charpentier en novembre 1946. Jean Schmit, qui bénéficiait d’un laissez-passer des autorités allemandes, ne fait l’objet d’aucune condamnation devant la CNIE, invoquant des pressions exercées par l’occupant.
Le couple Zacharie et Alexandra Birtschansky est également mis hors de cause devant la CNIE et le CCPI. Zacharie étant juif, les ventes aux Allemands avaient permis de dégager des fonds pour soutenir sa fuite en zone libre. Le chiffre d’affaires réduit et le fait que ces ventes concernaient leur collection privée ont également joué en leur faveur. Alfred Daber, la galerie Manteau, Paolo Aflallo de Aguilar, André Camoin voient les poursuites devant la CNIE abandonnées en raison du volume réduit des transactions.
Certains font valoir des actions de résistance comme Garbis Kalebdjian qui a caché de nombreux biens juifs ou bien la Maison Jansen qui a aidé des réfractaires au STO et caché des pièces privées. Jeanne Batifaud, condamnée par le CCPI, voit son affaire classée par la CNIE au regard des œuvres qu’elle a cachées et des ventes effectuées au profit de Juifs, même si la frontière entre le soutien sincère et le profit de guerre est mince.
César Mange de Hauke a aussi connu une double activité durant la guerre, travaillant d’un côté à la sécurisation des biens de son employeur Seligmann, basé aux États-Unis, tout en menant une activité marchande avec l’occupant. Georges Terrisse fait partie d’un groupe résistant visant à cacher les œuvres et à surveiller les ventes publiques, mais est aussi adhérent au Rassemblement national populaire. Ce profil ambivalent et les services rendus jouent en sa faveur devant la chambre civique et la CNIE, même si les archives des chambres civiques démontrent qu’en général une adhésion attestée à un mouvement collaborateur aboutit de manière systématique à une reconnaissance d’indignité nationale.
Le tableau général paraît donc clément, surtout au vu des difficultés évoquées au sujet du recouvrement des amendes et des possibilités de recours en suspension ou en minoration. Les acteurs du marché de l’art ont bénéficié d’une forme de dissociation écartant leurs profits de toute suspicion de collaboration. Nonobstant les faits avérés de résistance pour certains d’entre eux, les marchands d’art peuvent très bien se positionner comme acteurs passifs d’un système contraint. Le retrait des affaires après la guerre, loin d’être courant, a pu aussi servir d’argument, comme une forme d’expiation ou d’innocuité reconnue par les comités. Pourtant, au-delà du volet fiscal dûment condamné, ce trafic touche au cœur de la culture et de l’identité des personnes spoliées. Et quand bien même les œuvres ne seraient pas issues de telles spoliations, il participe à une entreprise globale d’instrumentalisation de l’art et de la culture par un régime prédateur. Le trafic de ces œuvres et le commerce renouvelé avec l’occupant auraient donc pu être analysés au prisme du comportement « vichyste » qui a motivé la création de l’indignité nationale.
L’expertise de Michel Martin, rapporteur de la CNIE, a fortement pesé. Ses rapports marquent aussi une volonté de préserver les intérêts de la profession et du marché, donc la réputation de certains acteurs dont on a jugé la compromission compatible avec la société d’après-guerre. Dans l’affaire touchant Joseph Leegenhoek, M. Martin insiste sur « l’intérêt pour la profession qui s’attache au commerce de M. Leegenhoek du fait qu’il exporte sur les marchés belge et hollandais sur lesquels il paraît particulièrement bien placé6 ». Sur ces arguments, la CNIE classe l’affaire mais la transmet au CCPI qui le condamne à des confiscations et amendes.
Le chemin judiciaire fut identique pour Allen Loebl, propriétaire juif de la maison Kleinberger. Reconnaissant les contraintes qui pesèrent sur son activité, Michel Martin atteste aussi de « l’honorabilité d’une maison anciennement réputée et aujourd’hui encore très bien disposée vis-à-vis des Musées nationaux7 », permettant le classement de son dossier par la CNIE.
En conclusion, le marché de l’art ne constitue pas une anomalie dans le paysage global de l’épuration. Il reflète les mêmes indulgences, la même volonté de déplacer les sanctions sur le terrain fiscal plutôt que moral ou pénal. Seul diffère un entre-soi protecteur peut-être plus net que dans d’autres corps professionnels moins structurés par le jeu de réseaux personnels. Ce panorama général appelle une étude approfondie, au cas par cas, seule à même de restituer de manière fidèle la colorimétrie des jugements apportés par la société et le droit à la Libération.
Données structurées
Personne / personne

Personne / personne
Personne / collectivité