
CAHEN D'ANVERS Hugo (FR)
Une vie franco-italienne
Entre Paris et Rome, fort de relations entretenues par sa famille, Hugo Cahen d’Anvers grandit dans un milieu huppé. Il fréquente les jeunes gens de l’aristocratie de l’époque, la Cour royale italienne et les rejetons de cette haute bourgeoisie juive dont sa famille fait partie. Son grand-père, Meyer Joseph (1804-1881), qui avait adopté le « d’Anvers » au moment de son établissement à Paris (1849), était l’un des fondateurs du réseau bancaire d’où dérive le groupe BNP Paribas. Son père Édouard (1832-1894) avait été l’un des grands responsables de l’aménagement urbain de Rome, après la chute de la papauté. Les revenus acquis lui avaient permis d’acheter un immense domaine entre l’Ombrie, la Toscane et le Latium, dominé par le château de Torre Alfina, auquel il avait lié son titre de marquis (Legé A. S., 2022). L’enfance de Hugo et de son frère aîné Rodolfo (1869-1955) est marquée par la perte prématurée de leur mère Christina Spartali (1846-1884), muse des peintres préraphaélites, d’origine gréco-orthodoxe, qui avait servi notamment de modèle pour La Princesse du pays de la porcelaine de James McNeill Whistler (Freer Gallery of Art, Washington ; voir Tsui A., 2010). Tombée dans une forte dépression, elle ne survécut aux traitements de l’époque : la morphine, le chloral et l’électrochoc.
Formé à l’École militaire d’Orvieto à partir de 1890, Hugo Cahen d’Anvers continue à exercer périodiquement dans l’armée jusqu’à 1918. À la mort de son père, pendant que son frère poursuit l’agencement du château de Torre Alfina, il hérite du versant du domaine donnant vers l’Ombrie. Il fait élever une villa près du village d’Allerona – la Villa della Selva – et il tente de transformer ses terres en de florissantes exploitations agroforestières (Rome, Arch. Not., Reg. 2935-431, rep.1451). Il investit dans l’agriculture, dans l’élevage et dans le commerce du bois. Aux côtés d’une famille de notables locaux, les Bernardini, il fonde une cave coopérative et se lance dans l’exportation de vin et d’huile d’olive ombriens à l’étranger (Rome, Cassa di Risparmio, Sez. XVI 1, b. 23, fasc. 143). Très attaché à la communauté locale, il obtient la croix de l’ordre du Mérite du travail en 1900 (Il Comune, 1910, p. 3). À la même époque, il épouse Ida Bertinoro, une dame italienne, probablement catholique, née à Naples en 1879 (Urbani C., 2002, p. 186). Le couple, qui n’a pas de descendants, s’établit dans sa nouvelle villa en 1905 et adopte officieusement deux enfants : Gino Raffaele Valentino Sezzi (n. 1904) et Egle Carletti. Cinq ans plus tard, Hugo Cahen d’Anvers rejoint le conseil municipal d’Allerona. En 1915, bien qu’engagé à Vérone dans le VIe régiment alpin, il obtient et accepte avec enthousiasme son premier mandat de maire. Néanmoins, sans peut-être le savoir, les notables du village viennent de le piéger dans un tourbillon de responsabilités qui, dans l’après-guerre, va se transformer en une cascade de dettes. Dans son rôle institutionnel, Hugo Cahen d’Anvers se trouve représenter l’État en même temps que la communauté locale et ses propres intérêts. Il doit répondre aux réquisitions menées par les autorités militaires, aux dépenses liées à la subsistance des vétérans, aux dettes de ses métayers (Legé A.S., 2022, p. 510-512).
La vague de grèves qui se déclenche pendant l’été 1919 ne peut qu’empirer sa situation. Dans cette période qui a pris ensuite le nom de Biennio rosso, les actions de plusieurs syndicats bouleversent la région d’Orvieto, rassemblant parfois quatre ou cinq milliers de paysans. Dans une situation économique précaire, Hugo Cahen d’Anvers préfère abandonner son domaine et regagner la France. La Villa della Selva est vendue le 23 juillet 1920 (Rome, Arch. Not., Reg. 4363-187/273, n. 87018). Avec son épouse, il s’établit au numéro 10 de l’avenue Alphand : Paris est chargée de promesses. Nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1928 (Paris, Arch. Lég. d’hon., dossier étrangers, s.c.), il continue à fréquenter un milieu aux allures italophiles, proche de l’ambassade où travaille son frère Rodolfo. Son épouse Ida, qui tient salon, accueille régulièrement la femme du futur ambassadeur Emmanuel Peretti della Rocca (1870-1958). Parmi ses hôtes figurent également l’ambassadeur américain Myron T. Herrick (1854-1929) et la marquise de Casa Maury (1898-1986), maîtresse du prince de Galles, Édouard VIII d’Angleterre.
Ces fastes s’interrompent brusquement dans les années 1940. Mis en danger par les horreurs de la guerre et par ses origines juives, Hugo Cahen d’Anvers trouve refuge à Nice, en zone libre. C’est là qu’il s’éteint le 24 janvier 1956 (Nice, État civil, Acte de décès, n. 302). Ses cendres sont déposées au cimetière de Saint-Georges à Genève, à côté de celles de son frère et, plus tard, de celles du fils adoptif (et compagnon) de ce dernier, Urbain Papilloud (1895-1987).

Le goût du voyage
À partir du début du XXe siècle, Hugo Cahen d’Anvers profite de la fortune héritée de son père pour se consacrer à sa passion pour les voyages. En 1900, il emmène son épouse à bord de l’Empress of Japan : un paquebot à vapeur, également connu sous le nom de Queen of the Pacific,qui relie régulièrement la côte de Vancouver au Japon. Dans les années qui suivent, d’autres déplacements transatlantiques côtoient des séjours de longue durée : en 1952, il réside à Shanghai (Legé A.S., 2020, p. 500). Ses intérêts se reflètent également dans son inscription précoce au Touring Club de France et dans sa participation à des expéditions tout à fait singulières. Le 27 avril 1911, l’aéronaute Jules Dubois (1862-1928) gagne la coupe Robert-Denoncin de l’Aéro-Club de France, en effectuant un vol en montgolfière de 1 010 kilomètres. Lors de son premier essai, le 20 juin 1910, Dubois n’est pas seul : c’est Hugo Cahen d’Anvers qui l’accompagne dans cette mission vertigineuse, qui démarre à l’usine à gaz hydrogène de Lamotte-Breuil, dans l’Oise (L’Aérophile, 1911, p. 373). Admis à l’Aéro-Club de France en 1909, Hugo avait déjà effectué au moins un voyage au cours de cette même année 1910. Le 20 juillet, nous le retrouvons en ballon, avec Dubois et leurs épouses respectives, dans un parcours qui se déroula sur les 64 kilomètres qui séparent la banlieue parisienne du village de Morville-en-Beauce, dans le département du Loiret (L’Aréophile, 1909, p. 381). En 1910, il s’associe également à l’Automobile-Club de France. Quelques années plus tard, en 1935, il se rend en Algérie et au Maroc, où il opère en tant que photographe. Accompagnés par Edmond Chaix (1866-1960), président du Touring-Club de 1927 à 1938, Hugo Cahen d’Anvers et le reste du groupe sont accueillis par les autorités coloniales des deux pays et accomplissent un parcours de 6 000 kilomètres, traversant le Sahara. Un article paru dans La Revue du Touring Club de France, illustré par plusieurs clichés pris par Hugo, nous offre un beau témoignage de ce séjour au Maghreb (Chaix E., 1935, p. 261-267). Deux ans plus tard, en 1937, il ose davantage. Avec une caravane de douze touristes, principalement d’origine belge, il part pour le Congo. Son groupe débarque au port d’Oran, en Algérie, et traverse l’Afrique par voie terrestre touchant les villes de Gao, au Mali, de Niamey, au Niger, et encore Fort-Lamy – c’est-à-dire N’Djamena, la capitale actuelle du Tchad. Le voyage se poursuit à travers celle qui était l’Afrique équatoriale française, touchant notamment la ville de Bangui, qui est aujourd’hui la capitale de la République centrafricaine (Les Annales coloniales, 1937, p. 2). Aux côtés d’Hugo Cahen d’Anvers se trouvent deux personnages très en vue à l’époque : Martin Birnbaum (1878-1970), marchand d’art et mécène associé de la Scott & Fowles, et l’artiste américain Carl Werntz (1874-1944). Ce dernier est un des élèves d’Alphonse Mucha (1860-1939) et partage la passion d’Hugo pour l’Asie et les voyages. Si notre latifundiste revient de ses pérégrinations fort d’une culture vaste et multiforme, c’est également grâce aux contacts humains qu’il établit pendant ses nombreux déplacements. Ainsi, rentrant à Paris ou plus tôt à Allerona, Hugo conjugue le pragmatisme du bâti aux rêveries d’un Orient fantasmé. En Italie, ses inspirations multiples se reflètent dans l’œuvre du paysagiste Achille Duchêne (1866-1947), aussi bien que dans les collections d’art éparpillées dans les espaces de la villa. Si ses jardins, ses orchidées et ses objets lui permettent de rester en strict contact avec ses passions, la rationalité des espaces lui offre un cadre de travail privilégié.
Le monde dans un jardin : Villa della Selva et l’Orient
Aux formes sévères et imposantes du château hérité par son frère à Torre Alfina, Hugo Cahen d’Anvers préfère le dessin épuré d’une villa enveloppée par la forêt : la Villa della Selva. Il y habite à partir du 1er janvier 1905, mais les travaux se poursuivent jusqu’à l’année 1912, par l’ajout de plusieurs dépendances et locaux de service. Son parc, probablement projeté par Achille Duchêne, porte dans ce coin de l’Ombrie les charmes du Japon, par l’installation d’un jardin du style Tsukiyama. Dans son univers miniaturisé, fait de collines, rivières et cascades, se condense la passion d’Hugo Cahen d’Anvers pour l’Orient et la nature. Des bassins en pierre, traversés par un pont et ornés par des lanternes, s’étendent tout au long d’un dénivellement qui débute près de l’entrée de la villa et rejoint le niveau de l’Orangerie. Tout à fait cohérent avec son intérêt pour l’Asie, cet espace est probablement l’un des premiers jardins japonais réalisés en Italie : Marco Maovaz identifie son seul antécédent dans le jardin de la Villa Melzi, à Bellagio, sur les rives du lac de Côme (Maovaz M. et Romano B., 2002).
Une photographie aérienne conservée à l’Aerofototeca della Regione Umbria nous permet d’apprécier la complexité du parc (Pérouse, AR08 1977, STR.43). Sa surface, occupée dans ses neuf dixièmes par des futaies de chênes, est séparée du reste du domaine par des haies. Quatre aires différentes chargent la villa d’allusions et suggestions multiples. Le jardin régulier se développe sur la terrasse. Deux aires à l’anglaise permettent aux visiteurs de profiter d’une nature présumée sauvage et servent d’éléments de transition entre la villa et ses bois. À l’ouest se situe le jardin japonais. Du côté opposé, se trouve une zone consacrée aux plantes tropicales, où l’on a installé quatre grandes serres : chez Hugo Cahen d’Anvers l’attention pour le collectionnisme in vivo égale celle qu’il consacre aux arts de l’Extrême-Orient.
En effet, au tout début du XXe siècle, ce goût pour le Japon qui envahit l’Europe à partir des années 1850, touche également l’agencement des parcs. De nombreux jardins japonais tels que ceux de Tully (Irlande), d’Exbury (Angleterre) et de Cowden (Écosse) surgissent au-delà de la Manche. D’autres sont réalisés en France pour Hugues Krafft (1853-1935) et la duchesse de Persigny (1832-1890) ou encore par des familles de la haute bourgeoisie financière telles que les Rothschild ou les Kahn. Hugo Cahen d’Anvers ne se limite pas seulement à la reproduction d’atmosphères de l’Extrême-Orient : sa reconstruction esthétique joint la recherche d’une certaine cohérence botanique. Dans les deux premières décennies du XXe siècle, il participe à plusieurs expositions horticoles en France et en Italie, présentant des spécimens d’aracées Platyceryum, d’Anthurium scherzerianum Schott et des palmiers Phoenix roebelenii O’Brien. À Allerona, participant activement à la conception des espaces verts, il y fait implanter plusieurs espèces des genres Rhododendrum, Hydrangea, Paeonia et Viburnum. Originaires des aires montagneuses de l’Asie centrale, ces plantes lui permettent de donner à son jardin une allure ultérieurement orientale, tout en résistant aux conditions climatiques des collines de l’Ombrie.
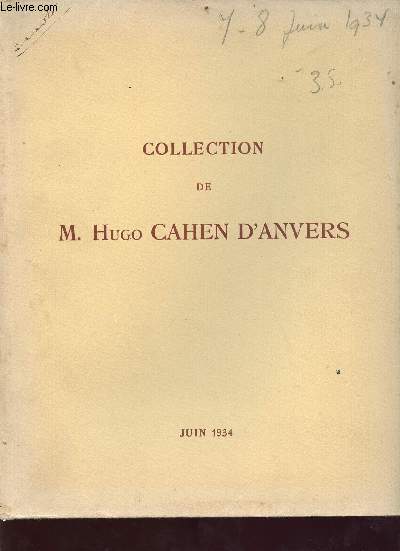
Deux ventes, une collection
Dans les appartements romains de son père, à Palazzo Nunez-Torlonia, plusieurs porcelaines génériquement identifiées par les inventaires comme « chinoises » ou « japonaises » anticipent un goût pour l’Extrême-Orient qui est plus tard développé par Hugo Cahen d’Anvers. La passion pour l’Asie qu’il reverse dans la botanique et les voyages se reflète également dans ses collections d’art. Dans les années du Japonisme et du grand retour de ces arts de Chine qui avaient déjà passionné l’Europe du XVIIIe siècle, le goût d’Hugo se développe parallèlement à celui d’autres membres de sa famille. Les collections de sa tante Louise Cahen d’Anvers née Morpurgo (1845-1926) étaient largement connues. Une autre importante collection se trouvait chez Emma Cahen d’Anvers (1833-1901) et son mari Édouard Levi Montefiore (1826-1907), dans l’hôtel de l’avenue Marceau (Montefiore R., 1957, p. 22, 76-77).
Mis à part les quelques objets qui sont exclus du contrat de vente de la Villa della Selva en 1920, la nature exacte des collections que Hugo Cahen d’Anvers conservait à Allerona semble destinée à rester enveloppée par le brouillard. En 1934, deux ventes aux enchères dispersent ses objets d’art : les catalogues de la galerie Jean Charpentier (7-8 juin, 249 lots) et de l’hôtel Drouot (11-13 juin, 417 lots) tiennent trace de la provenance des objets et nous permettent d’observer qu’il forme le cœur de ces recueils autour de 1925, soit cinq ans après son retour en France. Les deux ventes encaissent respectivement 965 000 et 183 000 francs.
D’une manière générale, les deux catalogues de vente laissent paraître la prédilection d’Hugo Cahen d’Anvers pour les objets d’art chinois, qui gardent une primauté quantitative évidente sur les artefacts japonais, ou encore sur un petit groupe de statuettes du Tibetet de Birmanie. L’ensemble vendu à la galerie Jean Charpentier se compose d’un grand nombre de lots de porcelaines, d’émaux cloisonnés, d’étoffes, de meubles et de pierres dures. À côté d’un nombre important de productions du XIXe siècle se trouve un corpus d’objets particulièrement remarquables. Rentrés dans les collections Cahen d’Anvers en 1925, un grand paravent en émail cloisonné, un brûle-parfum, une vasque en porcelaine décorée en émaux polychromes et une grande psyché en bois incrusté de nacre quittent la Chine vers 1900 (Catalogue des objets d’art, 1934a, cat. 212, 246, 190, 248). Pillés dans les collections impériales, ces objets sont rapportés en France par le général Cluzeau, aide de camp de Régis Voyron (1838-1921) qui commande le corps expéditionnaire de France pendant la révolte des Boxers (1899-1901). À cette époque, les palais impériaux de Pékin sont lourdement spoliés par les troupes européennes. Le journal de l’écrivain français et officier de marine Pierre Loti (1850-1923) nous offre un témoignage précieux des modalités dans lesquelles ces objets sont prélevés (Zurich, Asien-Orient-Institut, Journal de Pierre Loti). En 1900, envoyé avec le général Cluzeau « dans un des palais de l’Impératrice », Loti prépare le terrain à l’arrivé de ses supérieurs, « au milieu d’un désarroi de choses merveilleuses », où il sait pouvoir « faire du pillage ». Ses souvenirs nous offrent un aperçu glaçant des conditions qui portent à la floraison de tant de collections d’art chinois en Europe.
D’autres objets qui partagent une provenance de tout premier ordre, rejoignent la collection d’Hugo Cahen d’Anvers depuis celles d’Adolphe Worch (1843-1915), du banquier italien Camillo Castiglioni (1879-1957), du marquis Frederick Oliver Robinson de Ripon (1852-1923) et d’Aloys Revilliod de Muralt (1839-1921).
Hugo rassemble également un intéressant corpus de peintures (Catalogue des objets d’art, 1934a, cat. 226-235). Parmi celles-ci se trouve une peinture sur soie où l’on reconnaît les serviteurs des écuries impériales, promenant des chevaux. Provenant de la collection Sevadjian, elle porte la signature de « Tchao Mong Fou ». Une autre peinture était passée dans les mains de Louis Gonse. Il s’agit d’une œuvre japonaise du XVIIe siècle. Peinte sur soie, elle représente un faucon perché sur le tronc d’un saule : dans un cachet l’on lit le nom de Kano Sanraku (1559-1635), peintre et protégé du daimyo Toyotomi Hideyoshi (1537-1598).
D’un caractère presque encyclopédique, la collection d’Hugo Cahen d’Anvers inclut également un ensemble de tissus et d’étoffes. Dix-neuf lots de meubles extrême-orientaux font preuve de la cohérence souhaitée par Hugo dans ses lieux de vie. La structure de la Villa della Selva témoignait déjà d’une recherche intellectuelle liant la culture européenne du propriétaire à son goût pour l’Asie. Une fois de plus, le mobilier vendu à l’hôtel Drouot montre la sensibilité du collectionneur pour le rapport qui lie le conteneur au contenu, la demeure à la collection. La dispersion d’un recueil de livres consacrés aux arts de l’Extrême-Orient témoigne d’une certaine recherche intellectuelle. Néanmoins, à l’exception des pièces les plus importantes, la collection d’Hugo Cahen d’Anvers se présente plus comme une « collection d’ameublement » que comme une « collection de vitrine ». Elle paraît le fruit du travail d’un amateur passionné, mais non pas celle d’un érudit. Cela est par exemple attesté par l’absence de tout spécimen chinois de provenance archéologique. L’intérêt « académique » qui, après 1918, pousse de nombreux collectionneurs vers ce type d’artefacts – plus chers et moins voyants ! – ne trouve pas son terrain chez le fils cadet du marquis de Torre Alfina. Au contraire, Hugo s’aligne aux pratiques « esthétiques » des grands collectionneurs du XIXe siècle : avec leurs couleurs éclatantes, les porcelaines chinoises répondent parfaitement aux nécessités d’un goût bien établi, qui lie l’image de la Chine à l’abondance sinueuse de décors.
Tout comme ses collections botaniques, les objets d’art de Hugo Cahen d’Anvers reflètent son désir de condenser dans les espaces de sa demeure les beautés de mondes lointains. À Allerona, une conception unitaire lie les jardins aux collections, en passant par les espaces de réception de la villa. Ainsi, par le dessin de ses perspectives, par ses parements et par son contenu, la Villa della Selva se présente comme le miroir d’un homme du XXe siècle qui avait connu l’Orient. Une construction identitaire du même type se reflète dans l’ameublement de l’appartement de Hugo, avenue Alphand. En Italie, des objets et des fleurs, venant des colonies et des pillages, trouvent paisiblement leur place dans les belles salles d’une demeure qui s’inspire de la Renaissance italienne, tout en s’ouvrant au monde. Spoliés de toute sacralité, les artefacts de l’Extrême-Orient approchent les cultures lointaines dont ils sont le fruit, de l’intellection rationnelle et taxonomique de l’Europe. La recherche, souvent illusoire, de la compréhension de l’autre se mélange à une volonté de dominer la réalité par l’édification de sa propre image publique.
Notices liées
Personne / personne

Collection / collection d'une personne

