
GONSE Louis (FR)
Genèse d’un historien connaisseur
Louis Gonse est né le 16 novembre 1846 à Paris. Il s’est éteint dans cette même ville le 19 décembre 1921. Fils d’Emmanuel Gonse, conseiller à la cour de Rouen, il fait son droit entre 1865 et 1870, tout en étant auditeur libre à l’École des chartes. Dans sa jeunesse, il entreprend de nombreux voyages en France, en Allemagne, en Italie et en Algérie. De ces derniers sont issus ses premiers écrits, récits de voyage ou critiques de Salons. Mais c’est en fréquentant l’École des chartes, où il noue des liens d’amitié et d’admiration avec plusieurs de ses confrères, qu’il conçoit véritablement sa vocation d’historien de l’art.
C’est là, en particulier, que son goût pour le gothique français et pour les « primitifs » européens commence à se manifester – ce qui conditionnera son intérêt postérieur pour l’art japonais, dont il a toujours voulu souligner les « rapports intimes » avec « notre art français du XIIIe siècle » (Gonse L., 1883, vol. 2, p. 89) ; là aussi qu’il se prend de passion pour la défense du patrimoine français – monuments historiques autant que collections muséales –, là qu’il se convainc de la valeur signifiante des objets pour bâtir un discours d’histoire de l’art, et là, surtout, qu’il intègre un milieu grâce auquel, rapidement, il peut gagner une certaine respectabilité dans le monde des écrivains d’art. À moins de trente ans, en février 1875, il accède au poste de rédacteur en chef de la Gazette des beaux-arts, une revue française de critique et d’histoire de l’art. Son action à la tête de cette publication savante renommée est remarquable d’audace et d’habileté. Conjointement à l’orientation traditionnelle d’un organe qui donne une place de choix aux études sur l’art européen classique de la Renaissance, il y associe de nouveaux horizons – les arts non européens, les arts décoratifs, l’art français non académique – qu’il sait rendre acceptables par le sérieux avec lequel il met en œuvre leur présentation et leur défense.
Ce n’est qu’à l’occasion de l’Exposition universelle de 1878, à Paris, que s’affirme vraiment la volonté de mettre l’accent sur les arts non européens, auxquels Louis Gonse rend hommage en ouverture des deux gros volumes réunissant l’ensemble des articles publiés par la Gazette sur l’Exposition : il y souligne la qualité des pavillons chinois, japonais, algérien, persan, etc., y admire « l’accumulation sans précédent de trésors artistiques de l’Extrême-Orient » (Exposition universelle de 1878, 1879, p. 16). Ses articles ou ceux de ses proches – Lucien Falize (1839-1897), Paul Mantz (1821-1895), Ernest Chesneau (1833-1890), Louis Duranty (1833-1880), etc. – associent souvent des aperçus historiques à la description des formes, mais ils sont surtout motivés par un combat que Louis Gonse reprend à son compte et qui culminera bientôt avec l’Art nouveau : « Essayer de rajeunir les styles des époques de naïveté et d’invention, en les appropriant à nos usages, à nos goûts et à nos besoins » (Exposition universelle de 1878, 1879, p. 340), et réanimer, ce faisant, la production décorative française face à ses concurrents britanniques ou allemands.
Un enthousiasme fécond pour l’art japonais
C’est en octobre 1883, quelques mois après avoir organisé une Exposition rétrospective de l’art japonais (Paris, galerie Georges Petit, avril-mai 1883), que Louis Gonse publie les deux lourds et luxueux volumes de L’Art japonais, avec ses milliers d’illustrations, puis sa réédition sous forme maniable et populaire, en 1886, 1891, 1900, 1904 et 1926, sa traduction en anglais en 1891 et en japonais en 1893. Les débats passionnés auxquels ce livre donne lieu et les nombreux articles que Louis Gonse en tire lui-même par la suite sont autant de signes de l’importance de l’événement, à la fois chez les savants, les collectionneurs ou les marchands et chez les artistes ou les décorateurs.
L’amour de Louis Gonse pour les arts du Japon a puissamment contribué à ouvrir et à orienter son regard sur la peinture et sur les arts décoratifs de son temps. On touche là au cœur de sa vie, pendant près d’un tiers de siècle, entre 1873 (lorsqu’il manifeste des premiers signes d’enthousiasme à l’occasion d’un compte rendu de l’« Exposition orientale » qui présentait la collection Cernuschi au palais de l’Industrie) et 1902 (date de son dernier article sur l’art japonais). Là encore ses écrits ne prennent tout leur sens que dans le contexte de sa participation à un milieu d’amateurs au sein duquel il a joué un rôle de premier plan.
Il n’est que de rappeler l’hommage que lui rend Raymond Kœchlin (1860-1931), un de ses alliés dans le même combat, à l’ouverture de son propre livre de souvenirs publié en 1930 : « Nul n’était plus qualifié que lui [Louis Gonse] pour nous donner ce chapitre de l’histoire de la curiosité. S’il n’avait pas été des tout premiers amateurs qui, aux environs de 1860, fréquentèrent les boutiques où commençaient de paraître les bibelots japonais – ce n’était qu’un enfant à l’époque –, il connut dans la suite ces pionniers et partagea leurs enthousiasmes de débutants ; les collectionneurs de la seconde génération, vers 1890, avaient tous été ses amis ou ses élèves » (Kœchlin R., 1930, p. 1-2).
Dans ce cadre, on peut considérer Louis Gonse comme l’incarnation presque parfaite de l’historien-connaisseur, pour lequel l’investigation historique est inséparable de la définition et de la défense d’un goût et dont les recherches sont donc primordialement fondées sur le contact direct avec les monuments et avec les œuvres. Souvent, cette priorité conférée au regard s’exerce au détriment de l’érudition livresque. À ce titre, il doit faire face aux critiques enflammées de l’autre grand spécialiste international d’art japonais à l’époque, Ernest Fenollosa (1853-1908) : du Japon où il est installé depuis 1878, l’Américain s’emporte contre l’ignorance, à ses yeux, où demeure Louis Gonse en ce qui concerne la peinture japonaise antérieure à la période d’Edo, contre sa valorisation de l’école vulgaire de l’estampe et surtout contre la thèse qui vise à exclure l’influence de la Chine comme facteur explicatif de la peinture japonaise (Fenollosa E., 1884).
Une approche novatrice de l’art japonais
Le premier objectif du directeur de la Gazette est de rendre aux arts japonais une historicité qui leur est déniée non seulement par le grand public, mais également par toute une frange de japonistes comme Edmond de Goncourt (1822-1896) – lequel n’a jamais cessé, pour cette raison, de moquer la pédanterie d’érudit de son contradicteur : « Il est, parmi les collectionneurs de japonaiseries, un prétentieux insupportable et un gobeur imbécile, c’est le nommé Gonse » (Goncourt (de) E. et J., Journal. Mémoires de la vie littéraire, éd. Robert Ricatte, 1956, jeudi 25 janvier 1883, p. 231). Le second grand objectif de Louis Gonse est de prouver que l’art japonais est un art national, qui a sans doute subi des influences mais qui ne doit à celles-ci ni son identité d’ensemble ni même ses inflexions les plus marquantes – ce qui le conduit à de graves mésinterprétations. Il développe également une approche délibérément racialiste, dans le sillage d’Ernest Renan (1823-1892) et surtout d’Hippolyte Taine (1828-1893), et rattache aussi souvent que possible le « génie » artistique de ce peuple à des racines indo-européennes, par d’obscurs raisonnements sur les flux migratoires et sur les types anthropologiques des populations juxtaposées dans l’archipel nippon.
Enfin – et c’est le principal –, son approche esthétique de l’art japonais est fondée sur une idée majeure, quasi obsessionnelle dans ses écrits : « Les Japonais sont les premiers décorateurs du monde » (Gonse L., 1886, p. 1). Cette proposition, qui ouvre la première édition de son livre (et qu’il n’a plus cessé de marteler), a une double fonction : d’abord, elle lui sert à souligner l’hétérogénéité radicale de la vision japonaise par rapport à la vision occidentale et la nécessité, pour l’aborder sérieusement, de « détruire les préjugés de race, les accoutumances de goût qui nous font hésiter devant les manifestations d’une esthétique nouvelle » (Gonse L., 1886, p. 3). Ensuite, elle le conduit à valoriser l’idée d’unité de l’inspiration artistique, où « ce que nous appelons les arts mineurs forment un tout inséparable avec les beaux-arts » (Gonse L., 1886, p. 61), d’un « minuscule netzké [sic] » à « l’ornementation d’un temple » (Gonse L., 1886, p. 131). Cette unité s’établit cependant toujours sous l’égide de la peinture, considérée en tant qu’art majeur au sens occidental du terme : « L’histoire de la peinture est, au Japon plus qu’ailleurs, l’histoire de l’art lui-même. […] La peinture est la clef ; sans elle, tout reste fermé à nos yeux. L’art entier en est issu et s’y subordonne » (Gonse L., 1886, p. 5).
Il en résulte une conception du décoratif aussi habile stratégiquement que novatrice esthétiquement : le décoratif, délivré de sa condition inférieure dans la hiérarchie occidentale des arts, devient une notion en soi, caractérisant non pas un type de production mais une conception générale de l’image, à laquelle la peinture n’est pas seulement redevable, mais dont elle est elle-même la matrice conceptuelle.
Un dernier pan des œuvres de Louis Gonse est consacré aux chefs-d’œuvre des musées de France, suite de lourds volumes dont le dernier est publié en 1904 ; il aspire par là à prendre la succession de Clément de Ris (1820-1882), en insistant toutefois sur une forme exigeante de vulgarisation de luxe, à connotation nationaliste. Enfin, au cours des quinze dernières années de sa vie, il sacrifie aussi bien le collectionnisme que l’écriture à une activité militante d’administration du patrimoine : il s’agit de son action au Conseil supérieur des beaux-arts, au Conseil des musées nationaux et, à partir de 1913, à la Commission des monuments historiques. Là, Louis Gonse œuvre, en sympathie avec de fidèles alliés comme Gaston Migeon (1861-1930) et Raymond Kœchlin, pour stimuler et renouveler la politique d’acquisition des grands musées (on cite souvent à son actif l’entrée au Louvre de la Grande Odalisque d’Ingres en 1899, parmi bien d’autres exemples) ainsi que le classement et la restauration des objets d’art au sein du patrimoine national. En cela, il n’est pas seulement un témoin de son temps, s’efforçant de conquérir de nouveaux domaines à l’histoire de l’art et de définir de nouvelles méthodes d’approche, entre le goût minutieux des objets et les généralisations racialo-nationales aussi vastes qu’ambiguës ; à sa manière prudente, il est aussi un esprit engagé, plus souvent enthousiaste que pessimiste, d’humeur jamais désabusée, dont les meilleurs textes constituent encore aujourd’hui une remarquable défense et une illustration de l’élan subjectif en histoire de l’art.
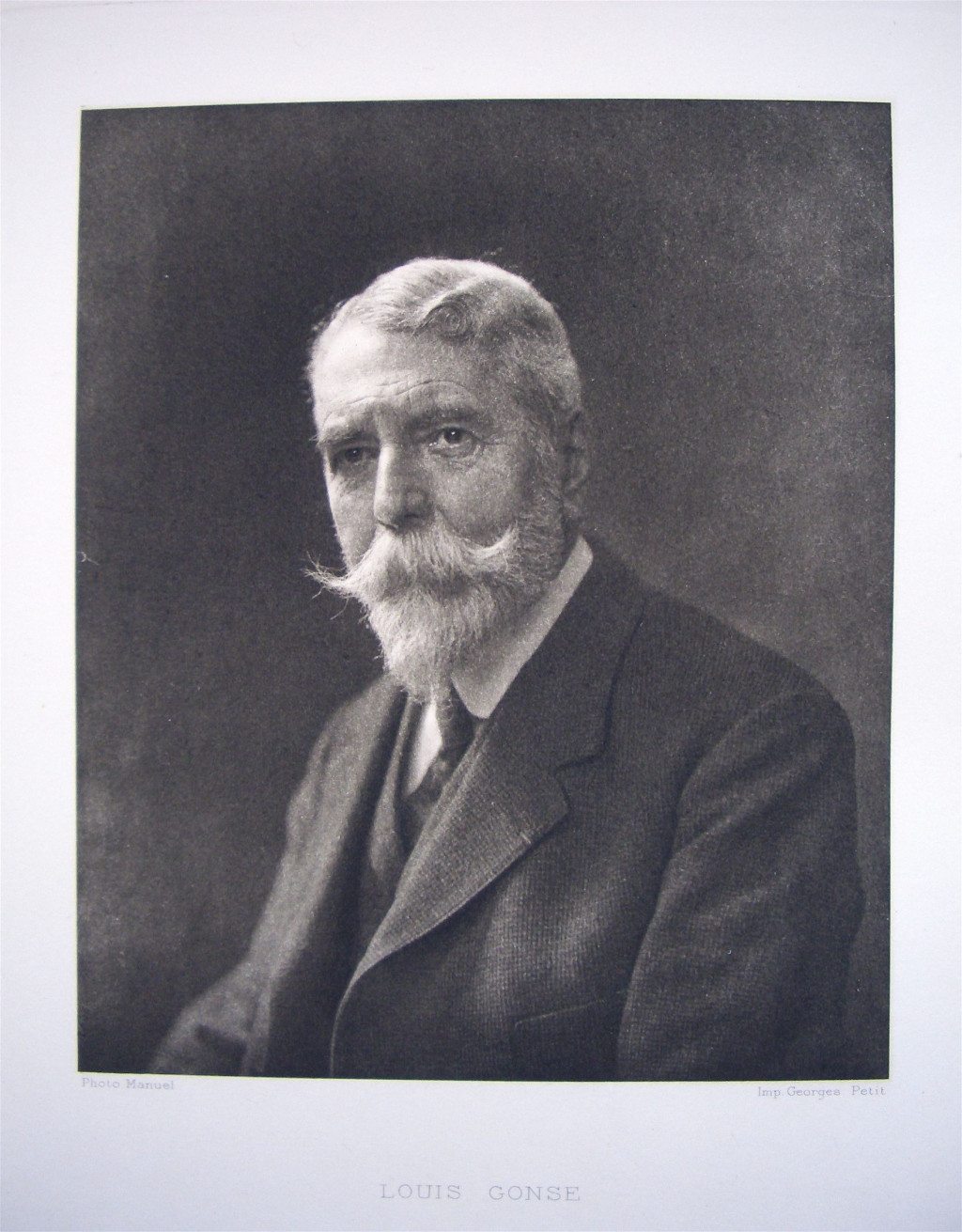
Un collectionneur connaisseur
Pour la réalisation de son exposition rétrospective de l’art japonais et de son livre sur l’art japonais en 1883, Louis Gonse a pu persuader Wakai Kenzaburo (1834-1908) de faire venir du Japon, pour les étudier, un ensemble de kakemono supposés antérieurs à la période d’Edo et exceptionnellement prêtés par des collectionneurs japonais (même si ceux que Louis Gonse prend pour des originaux, notamment de Kanaoka, le fondateur de l’école de Kose au IXe siècle, ne sont en fait que des copies ou des pastiches tardifs).
En tant qu’amateur, Louis Gonse a lui-même développé une forme de collectionnisme des arts du Japon, dont les choix ne sont pas dictés par le simple plaisir visuel mais par un désir encyclopédique de rendre compte de toutes les techniques et de toutes les périodes d’un art dont, à l’inverse des frères Goncourt, il fait remonter les origines « à une très haute antiquité, dès le VIIe siècle de notre ère » (Gonse L., 1883, vol. 2, p. 192).
Louis Gonse n’est ni un savant japonologue, ni un ethnographe voyageur, ni véritablement un partisan du japonisme appliqué à l’Occident ou un esthète pur et simple, mais plutôt un connaisseur dont l’activité est dictée par le désir de bâtir une histoire de l’art par et pour les objets. Dans L’Art japonais, il y a quelque chose d’un guide de l’amateur, ou, selon l’expression d’Ary Renan (1858-1900), d’un « grand herbier documentaire » (Ary R., 1884, p. 6), avec ses accumulations de noms d’artistes (accompagnés le plus souvent de la reproduction de leurs idéogrammes pour faciliter leur identification) et ses descriptions techniques détaillées (notamment pour les bronzes ou les laques) ainsi que ses jugements de goût péremptoires, souvent suivis de comparaisons pédagogiques entre tel artiste japonais et tel artiste européen : Fra Angelico (1400 ?-1455) pour Kanaoka, Corot (1796-1875) pour Motonobu (1476-1559 ?), Rembrandt (1606-1669), Callot (1592-1635), Goya (1746-1828) et Daumier (1808-1879) pour Hokusai (1760-1849), etc.
Il s’affirme ainsi, en Europe, comme le porte-parole particulièrement averti et influent d’un mouvement général qui, un quart de siècle environ après l’ouverture du pays à l’Occident, conduit à annexer les arts du Japon aux collections muséales occidentales. Ce faisant, son travail est mû, il le dit clairement, par le désir nationaliste de combler le retard de la France dans le domaine de la recherche par rapport à l’Angleterre et à l’Allemagne : « Nous demeurions en France dans une regrettable indifférence [à l’égard des questions d’art japonais], alors qu’à l’étranger – en Allemagne, en Angleterre et en Amérique surtout – elles éveillaient une si vive attention », écrit-il par exemple dans l’avant-propos du catalogue de son exposition rétrospective de 1883 (Gonse L., 1883, p. 5-6).
Dans l’ensemble, Louis Gonse a une conception performative de l’histoire de l’art, qui doit viser autant à accroître le savoir qu’à renouveler la création, non par l’imitation des formes, mais par leur transposition et leur adaptation en vertu de certains principes transculturels. Parmi ces principes, le principal est celui de « décoration », qu’il a d’ailleurs du mal à définir de manière stable : tantôt, il rapproche l’idéal décoratif de la primauté de la « jouissance sensorielle » sur l’intellection (Gonse L., 1888, p. 12) – tout en réclamant que l’artiste dispose d’une « éducation intellectuelle » pour « s’élever de la sensation à l’idée » (Gonse L., 1884, p. 150) ; tantôt, il associe la décoration aux notions de « synthèse » et de « simplification » (Gonse L., 1883, p. III) – mais y maintient l’exigence de « naturalisme », par l’imitation fidèle des formes de la nature (Gonse L., 1890, p. 371). Il se fait également le défenseur d’une forme d’esthétique fonctionnaliste, situant l’essence du décoratif dans l’adaptation « logique » des œuvres à un usage social et dans l’unité entre les arts – mais il n’en continue pas moins d’isoler et de mettre au premier plan les arts « majeurs » de la peinture, de la sculpture et de l’architecture, par rapport aux arts mineurs appliqués à la vie quotidienne.
La collection de Louis Gonse
Voir et manipuler des objets japonais est primordial à la compréhension, pour Louis Gonse, de l’esthétique japonaise. François Gonse, dans la série de remarquables travaux qu’il a consacrés à son aïeul, estime le point de départ de cette collection entre 1873 et 1875 – une collecte qui se serait prolongée jusqu’en 1904 (Gonse F., 1996, p. 484). Les objets issus de diverses collections, répertoriés dans L’Art japonais, sont donc pour Louis Gonse des « outils d’investigation à la fois scientifiques et esthétiques » (Gonse F., 1996, p. 2). En lien étroit avec les principaux marchands d’art japonais parisiens tels que Wakai Kenzaburo, Hayashi Tadamasa (1853-1906) ou Siegfried Bing (1838-1905) – lequel a rédigé le chapitre sur la céramique dans la première édition de L’Art japonais–, Louis Gonse a d’abord constitué une collection personnelle exceptionnelle, dont témoignent les milliers d’œuvres inscrites aux catalogues des ventes posthumes qui se sont succédé de 1924 à 1988. Les trois premières ventes de 1924 comprennent à elle seules 2 656 numéros.
Sa collection d’art japonais (environ trois mille pièces) est décrite en ces termes par François Gonse : « La collection Gonse en 1883, à la galerie Petit et dans L’Art japonais, résume à elle seule les recherches, les goûts et les préoccupations de l’ensemble des collectionneurs français et occidentaux autour des années 1880. Cette collection est sans doute la plus diversifiée de toutes les collections françaises de l’époque et la plus équilibrée en nombre d’objets par catégories » (Gonse F., 1996, p. 484).
En avril 1883, parmi les quelque 3 500 objets exposés à la galerie Georges Petit de la rue de Sèze, Louis Gonse en possède 1 183 ; 358 sont mentionnés dans L’Art japonais, dont 290 sont également reproduits. Il possède aussi à cette date 108 peintures (dont 66 kakemono, 6 paravents, 3 éventails peints, 8 makimono, 27 albums et 50 estampes japonaises). De surcroît, il détient 70 sculptures diverses (dont 29 bronzes), 172 netsuke, 177 laques, 20 armes et un masque d’armure (mempo), 138 tsuba, 81 kozuka, 43 étuis à pipe, 73 pièces d’étoffe (sont 33 fukusa), 131 céramiques et 140 objets divers (Gonse F., 1996, p. 484).
Par ailleurs, les convictions racialistes de Gonse sur les racines indo-européennes du peuple japonais l’ont conduit à manifester un intérêt pionnier pour les arts islamiques persans et moghols. À la suite de son ami Duranty, il les rapproche systématiquement de ceux du Japon, avec l’assurance de prouver ainsi que, aussi bien du côté des Arabes que du côté des Japonais, le « grand foyer civilisateur de l’Asie » (Gonse L.,1886, p. 36) est la Perse antique. C’est ce qui le pousse à devenir l’un des tout premiers, en Europe, à constituer une remarquable collection de miniatures mogholes et persanes, qu’il expose à Paris en 1893 et à nouveau, grâce à son ami Gaston Migeon, en 1903 au musée des Arts décoratifs.
Notices liées
Personne / personne

Collection / collection d'une personne

