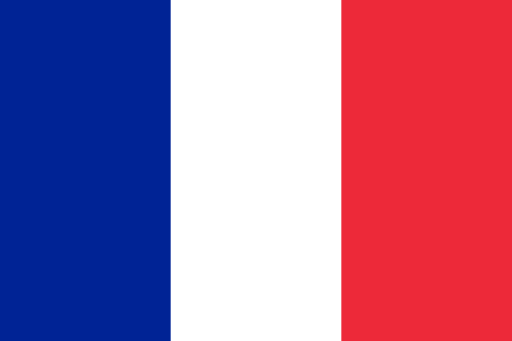Le modèle français de restitution et d’indemnisation des biens culturels spoliés entre 1940 et 1945. Un modèle original, judiciaire et administratif
Bientôt quatre-vingts ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le conflit dans certains de ses aspects continue de produire des effets dont témoigne l’actualité judiciaire et administrative. C’est le cas avec la spoliation des biens culturels mobiliers, spécialement perpétrée à l’encontre des Juifs en France durant l’Occupation. Soucieux de réparer les torts subis par les victimes, l’État a mis en place un modèle original de réparation, proposant deux types d’action aux particuliers désireux de recouvrer des biens culturels spoliés : l’une judiciaire, attestant d’une volonté de justice tôt affirmée par la France (1.), une autre administrative, qui débute dès la Libération puis, après une période de latence, qui est relancée à la fin de la décennie 1990-2000 dans le cadre d’une politique publique de réparation (2.).
Des restitutions judiciaires ordonnées sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945
En réaction à la politique de spoliation menée par le régime de Vichy entre 1940 et 19451, après la Libération, le législateur adopte le 21 avril 1945 une ordonnance2 s’inscrivant dans la continuité de mesures opposées, depuis l’année 1943, aux expropriations forcées et à l’aryanisation économique3. Le texte se compose de deux titres destinés à permettre aux propriétaires dépossédés d’exciper du contexte d’occupation pour recouvrer leurs biens spoliés4.
Le titre I vise les actes de disposition exorbitants du droit commun (spoliations, ventes forcées, etc.) réalisés après le 16 juin 1940 et prévoit leur nullité (articles 1 et 2), sans discriminer entre les victimes. En effet, le législateur de 1945 n’ayant pas souhaité inscrire dans la loi la singularité de la persécution des Juifs (infra), il semble avoir fait le choix d’une formule volontairement euphémisante (« mesures exorbitantes du droit commun »), laissant à la jurisprudence le soin de l’interpréter librement dans un sens favorable aux victimes de persécutions antisémites5.
Plusieurs articles importants dans ce titre insistent sur le souci de rétablir les victimes dans leur droit, quitte à déroger à certains principes fondamentaux du droit comme l’acquisition de bonne foi, la prescription des actions en revendication, ou encore la prescription acquisitive. C’est ainsi que l’article 4 répute « possesseurs de mauvaise foi », l’acquéreur ou les acquéreurs successifs d’une œuvre d’art ayant par exemple été cédée à l’occasion d’une vente sous administration provisoire durant l’Occupation. Cette disposition a été récemment retenue dans l’affaire consorts Bauer au détriment des époux Toll ayant acquis de bonne foi en 1995 un tableau de Camille Pissarro, La cueillette des pois, initialement confisqué à Simon Bauer et vendu le 1er octobre 1943 par son administrateur provisoire6. Contre la règle commune protégeant l’acquéreur de bonne foi, le législateur de 1945 a ainsi souhaité, par son article 4 réputant de mauvaise foi les acquéreurs successifs, faire primer l’intérêt du propriétaire spolié7. C’est ce raisonnement qui prévaut encore aujourd’hui, y compris au regard de certains droits fondamentaux (droit de propriété et droit au procès équitable)8. Or, l’une des caractéristiques faisant de l’ordonnance du 21 avril un texte exceptionnel est que son article 4, combiné à l’article 21 permettant au juge de relever le demandeur de la forclusion dans le cas où le propriétaire dépossédé peut apporter la preuve qu’il s’est trouvé, même sans force majeure, dans l’impossibilité matérielle d’agir dans le délai de six mois après la fin des hostilités, lui confère une portée virtuellement intemporelle9.
C’est pourquoi, bien que l’ordonnance ne soit plus mobilisée par le juge pendant une cinquantaine d’années à partir de 1950, elle est réactivée en 1999 par la cour d’appel de Paris, au fondement d’une décision de restitution de cinq tableaux inscrits sur les registres MNR (Musées nationaux Récupération). Le juge n’a pas hésité, en l’espèce, à relever de leur forclusion les ayants droit de Federico Gentili Di Giuseppe, dont la collection avait été vendue sous administration provisoire durant l’Occupation10. L’ordonnance du 21 avril 1945 a été depuis lors utilisée à deux reprises, dans les affaires Simon Bauer et consorts Gimpel11, et elle est actuellement mobilisée par les ayants droit d’Armand Dorville, aux fins de faire constater la nullité des ventes de sa collection organisées pendant l’Occupation.
Le législateur de 1945 était néanmoins conscient du fait que tous les périls encourus durant l’Occupation n’étaient pas couverts par le titre I de l’ordonnance. D’autres formes de spoliation devaient être traitées, dans le sens que leur donnaient la Déclaration solennelle de Londres du 5 janvier 194312 et l’ordonnance du 12 novembre 1943 précitée. C’est pourquoi le titre II de l’ordonnance du 21 avril 1945 élargit les actes de disposition forcés à ceux « accomplis avec le consentement du propriétaire dépossédé et relatifs à des biens, droits ou intérêts n’ayant pas fait préalablement l’objet de mesures exorbitantes du droit commun ». L’article 11 déclare notamment que certains actes accomplis avec le consentement de l’intéressé « seront présumés avoir été passés sous l’empire de la violence ». Le juge pouvait dès lors faire bénéficier de cette mesure des personnes de condition juive, en inférant que, vivant sous le coup de lois raciales, elles étaient exposées à « un mal considérable et présent », c’est-à-dire la violence au sens du code civil (article 1112 ancien). Cette disposition ouvrait la voie à des actions en nullité pour des transactions d’apparence légale portant sur des œuvres d’art. Toutefois, l’article 11 précise que la présomption de violence est réfragable lorsque la transaction a été conclue moyennant le paiement d’un juste prix. Lorsque l’exception de juste prix est accueillie, il incombe au demandeur de démontrer que la transaction a été conclue sous la contrainte. S’il parvient à apporter cette preuve, il peut obtenir la nullité de la transaction et la restitution du bien, moyennant le remboursement du prix encaissé. La difficulté majeure ici tient dans le fait d’apporter une telle preuve. C’est pourquoi dans l’affaire des tableaux de Derain spoliés à René Gimpel pendant l’Occupation, si les consorts Gimpel s’estimaient fondés à ce que soit appliqué au cas d’espèce l’article 11, la cour d’appel de Paris leur a donné raison en analysant toutefois ces ventes forcées au regard du seul article 1er.
Bien que rares, on décompte entre 1999 et 2020 trois restitutions prononcées par le juge sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945, pour un total de neuf biens culturels spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale13. La réactivation de ce texte plus de cinquante ans après son adoption ne doit rien au hasard. Elle s’inscrit dans le contexte d’adoption d’une politique publique de réparation en rapport avec les persécutions et la spoliation des Juifs durant l’Occupation.
Des réparations administratives résultant d’une politique publique de réparation
Dès la Libération, fort d’un socle juridique tôt adopté par le Comité français de libération nationale (CFLN) condamnant et frappant de nullité les actes de disposition exorbitants du droit commun commis durant l’Occupation, la France adopte un système de réparation des biens spoliés qui dédommage mécaniquement de nombreuses victimes juives, bien que le gouvernement n’ait pas explicitement souhaité constituer une catégorie spéciale de victimes comme le montre l’ordonnance du 21 avril 1945, à une période où l’unité nationale était indispensable à la reconstruction matérielle autant que morale du pays1.
Le processus de restitution matérielle s’appuie sur l’Office des biens et intérêts privés (OBIP2), chargé du recensement des biens de toutes natures spoliés à des particuliers, et sur un organisme spécifiquement compétent en matière de récupération des œuvres d’art spoliées, la Commission de récupération artistique (CRA3), créée par un arrêté du ministre de l’Éducation nationale du 24 novembre 19444. Les deux administrations coopèrent notamment en vue de la restitution des biens culturels mobiliers spoliés, entre 1940 et 1945, à leurs propriétaires.
Alors que l’on estime à environ 100 000 le nombre global de biens culturels mobiliers spoliés durant l’Occupation, entre 1944 et 1949, ce sont environ 60 000 objets qui sont retournés en France après avoir été retrouvés, tous n’ayant cependant pas été spoliés5. Un peu plus de 45 000 sont identifiés et restitués à 416 de leurs propriétaires. Il restait néanmoins environ 15 000 objets non restitués, faute d’avoir été réclamés ou identifiés par l’État. Or, le législateur ayant fixé un délai de prescription au-delà duquel aucune réclamation ne pouvait être enregistrée6, il a été décidé que les biens non réclamés seraient aliénés par l’administration des Domaines. Le décret du 30 septembre 19497 institue ainsi deux commissions ad hoc dites « commissions de choix »8, chargées de sélectionner parmi les 15 000 objets non restitués les pièces dignes de figurer dans les collections publiques. Entre octobre 1949 et juin 1953, les commissions de choix sélectionnent environ 2 100 biens culturels qui sont confiés provisoirement à la garde des Musées nationaux dans l’attente d’éventuelles restitutions. Ces biens sont enregistrés sur les inventaires dits de la récupération et sont depuis lors connus sous le sigle générique MNR (Musées nationaux Récupération). Quant aux 13 000 objets non sélectionnés, ils sont remis par l’OBIP à l’administration des Domaines et vendus au profit de la reconstruction.
Au début des années 1950, les réclamations s’essoufflent et les restitutions marquent le pas. Cela s’explique par la résignation des familles et par une volonté politique davantage préoccupée de reconstruction que de réparation9. Seules six restitutions de biens culturels mobiliers sont ainsi recensées entre 1953 et 199310. La décennie 1990 marque alors le début d’une nouvelle période où les restitutions reprennent. Certaines enquêtes journalistiques11 et des recherches académiques12 mettent au jour la présence d’un véritable « musée disparu »13 disséminé dans les collections françaises, ambassades et ministères, insistant sur l’existence d’une dette de réparation qui oblige les autorités politiques à réagir. Dans un discours prononcé le 16 juillet 1995 lors de la commémoration de la rafle du Vél’ d’Hiv’, le président français, Jacques Chirac, déclare alors que la République conserve « une dette imprescriptible » à l’égard des victimes. C’est le point de départ d’une politique publique de réparation qui sera matériellement mise en œuvre à la suite des conclusions de la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, présidée par Jean Mattéoli. Les travaux de cette mission s’inscrivent à l’époque dans un contexte international qui met en lumière le problème des biens spoliés durant la Deuxième Guerre mondiale14.
À l’issue de la remise des rapports de la commission Mattéoli, et sur sa recommandation, est créée en 1999 une Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation (CIVS)15. Instance non-juridictionnelle de réparation imaginée pour traiter les demandes individuelles qui commencent alors d’affluer, la CIVS est compétente pour recommander au Premier ministre, aux services duquel elle est rattachée, notamment l’indemnisation ou la restitution de biens culturels mobiliers spoliés durant l’Occupation. Cette mission de justice a déterminé un mode de délibération original, basé sur l’équité et fonctionnant au cas par cas ; une telle casuistique de l’équité est destinée à favoriser l’articulation entre le respect du droit en vigueur et le devoir moral de réparation. Le caractère exorbitant du droit commun d’une telle procédure ne peut être compris qu’à l’aune de la politique de réparation citée plus haut. Celle-ci a été adoptée dans un contexte social et politique reconnaissant, à partir des années 1970, le génocide des Juifs comme l’événement majeur de la guerre et après que la responsabilité de l’État français dans leur persécution, durant l’Occupation, a été officiellement reconnue en 1995.
Si le bilan de la CIVS reste mitigé en matière de restitution de biens culturels jusqu’au milieu de la décennie 2010, les résultats s’améliorent à partir de 2013 avec la recherche proactive des propriétaires spoliés16, et surtout après 2018, avec l’autosaisine de la commission17 et la dotation de nouveaux moyens18. La loi no 2022-218 du 21 février 2022, relative à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites, rend compte en partie de ces résultats encourageants19.
Construit sur le principe d’une dette de justice à l’égard des victimes, l’originalité du modèle français de réparation des spoliations de biens culturels tient autant à sa nature duale, judiciaire et administrative, qu’à sa quasi-imprescriptibilité. Pour autant, aussi exemplaire que soit cette politique de réparation, elle sera inévitablement confrontée à d’importants défis éthiques. En premier lieu, celui de la fin des réparations (restitutions et indemnisations), ce qui en droit pose la question de la prescription, mais encore celui du niveau générationnel acceptable, rattachant la victime directe aux ayants droit réclamant réparation20. C’est toute la difficulté et l’ambiguïté d’affirmer l’ambition politique de réparer une dette imprescriptible !
Données structurées
Personne / personne