
GAUTIER Judith (FR)

De la formation à la création
L’écrivaine, artiste et critique d’art Judith Gautier (1845-1917) a participé à tous les courants de pensée littéraires et artistiques français du XIXe siècle. La présente notice mettra l’emphase sur ses connaissances en ce qui concerne l’Extrême-Orient, ainsi que son rôle primordial dans la diffusion de l’intérêt européen pour l’art, la littérature et l’histoire de Chine, du Japon, d’Inde, de la Thaïlande, du Laos, d’Indonésie et du Vietnam. Pour une biographie détaillée, il convient de se reporter aux études de Joanna Richardson, Bettina Knapp et Véronique Chagnon-Burke qui évoquent la diversité de ses contributions littéraires (poésie, prose, théâtre) et artistiques (la sculpture, la critique artistique et musicale), ainsi que ses amitiés avec les membres des écoles littéraires (les romantiques et les réalistes, les parnassiens, les naturalistes et les symbolistes) (Richardson J., 1986, surtout la bibliographie en fin d’ouvrage, p. 285-293 ; Knapp B., 2007 ; Chagnon-Burke V., 2013).
La fille de l’influent homme de lettres Pierre Jules « Théophile » Gautier (1811-1872) et de la chanteuse « Ernesta » Giuseppina Jacomina Grisi (1816-1895), Louise Charlotte Ernestine « Judith » est née le 24 août 1845 à Paris (AD Neuilly-sur-Seine 2E27/57). Dans les livres de souvenirs qu’elle publie à partir de 1904, Gautier évoque le milieu bohémien de son enfance où elle fréquente les grands artistes et écrivains amis de ses parents (Gautier J., 1904 ; Gautier, J., 1905). Elle cite son père, comme l’origine de son amour pour l’Orient dès la rédaction du Roman de la momie (1857), auquel elle a contribué (Gautier J., 1904, p. 245-247). C’était pendant un voyage à Londres avec ses parents pour assister à l’Exposition universelle en 1862 que l’adolescente Judith Gautier dit avoir eu son premier contact direct avec l’Asie : deux Japonais en « costume national » entrent dans un magasin où elle essaie de « causer » avec eux (Gautier J., 1905, p. 132-134). Elle est fascinée autant par les détails de leur habillement que par leur découverte de la culture européenne : « On eût dit qu’autour d’eux, sans que rien s'en fût encore dispersé, flottait le parfum et comme l'atmosphère de leur fabuleux pays ». C’est une rencontre « fatidique » et « inoubliable » qui lui révèle « tout un monde inouï » (Gautier J., 1905, p. 134). Encouragée par son père, Judith Gautier se plonge dans la découverte de la littérature de l’Extrême-Orient.
Une autre rencontre fortuite met la famille Gautier en contact avec un exilé chinois, Ding Dunling ([丁墩龄],1831-1886 ; Gautier l’écrit « Ting-Tun-Ling »), qui commence – à partir de 1863 – à donner des cours de chinois à Judith et sa sœur Estelle (1848-1914) [Gautier J., 1905, p. 159-163]. Il leur apprend à prononcer les mots et à maîtriser l’écriture. Afin de diversifier les études, il leur raconte, de temps en temps, des légendes chinoises et leur parle des mœurs et des paysages des différentes régions de l’empire du Milieu. Ses cours passionnent les deux jeunes filles. Judith Gautier apprécie le dépaysement qu’ils offrent, lui permettant de voyager par l’imagination. Avec le soutien de son précepteur, elle commence à lire les ouvrages chinois. Elle possède une copie du dictionnaire chinois-français composé par Joseph de Guignes (1721-1800) et publié en 1813 (Dictionnaire chinois, français et latin), offert par le comte Olivier de Gourjault (1837-1891). Celui-ci s’avère très utile au cours de ses premières lectures des livres chinois (Gautier J., 1905, p. 203). Plus tard, elle fréquente la bibliothèque de la rue de Richelieu avec Ding Dunling, où ils copient des poèmes chinois et empruntent d’autres ouvrages qui vont inspirer ses écrits (Gautier J., 1905, p. 204-206).
En 1864, la chercheuse publie dans L’Artiste – sous le nom de « Judith Walter » – neuf poèmes traduits d’après les créations originales de cinq poètes chinois sous le titre Variations sur des thèmeschinois (Walter J., 1864, p. 37-38). L’année suivante, huit nouvelles traductions sont publiées dans la même revue (Walter J., 1865, p. 261). En 1867, sa première anthologie poétique, intitulée Le Livre de Jade, voit le jour (Walter J., 1867). Elle contient, en plus des 17 poèmes publiés antérieurement, 54 traductions supplémentaires. Le Livre de Jade est aujourd’hui considéré comme un des textes les plus influents pour la réception de la poésie chinoise en Occident (Yu P., 2015 ; Yu P, 2007).
L’année suivante, Judith Gautier publie son premier roman, Le Dragon impérial, ouvrage légendaire sur la Chine, paru d’abord en 33 épisodes dans La Liberté (23 mars – 27 mai 1868) et puis en volume par Lemerre en 1869. Il paraît sous le nom « Judith Mendès », car elle a épousé le poète Catulle Abraham Mendès (1841-1901) le 17 avril 1866 à Neuilly-sur-Seine (AD Neuilly-sur-Seine 2E27/57) après avoir refusé l’année précédente une demande en mariage de Mohsin Khan, M’uin ul Mulk, ambassadeur de Perse (dates inconnues ; Gautier J., 1905, p. 331-334 ; Richardson J., 2013, p. 27). Le mariage avec Catulle Mendès s’avère tout de suite malheureux et Judith obtient une séparation des biens le 13 juillet 1878 et un divorce le 28 décembre 1896 (Richardson J., 1986, p. 54-55, 108-112, 134 ; AD Neuilly-sur-Seine 2E27/57).
À la légation de Chine et du Japon en France
Si l’apprentissage du chinois et ses lectures forment un lien indirect entre Judith Gautier et le monde oriental qu’elle n’a jamais visité, ses échanges avec les envoyés et les voyageurs asiatiques à Paris, ainsi que sa participation aux événements interculturels, lui offrent de diverses occasions directes pour mieux connaître ces pays lointains. Grâce au milieu de son père et par l’intermédiaire de ses amis français, Judith Gautier fait la connaissance et entretient de bonnes relations avec les envoyés asiatiques. Son nom apparaît souvent dans les récits des voyageurs chinois qui délivrent d’importants témoignages sur la poursuite de l’apprentissage de la chercheuse française en dehors de ses cours de chinois à domicile (Shi Y., 2020). Judith Gautier visite fréquemment la légation de Chine en France et assiste à un grand nombre d’activités que les Chinois organisent à Paris. Nous le voyons dans les nombreuses « Notes sur la Chine » qu’elle publie dans le Journal officiel sous le pseudonyme « F. Chaulnes » du 31 juillet 1875 au 22 septembre 1876 (Chaulnes F., 1875-1876), où elle traite des sujets comme la médecine, les pratiques de mariage, la poésie, les cérémonies funèbres et la musique, présentant ainsi au grand public les récits qu’elle a entendus chez les diplomates chinois. En 1905, elle participe à la cérémonie de célébration pour la nouvelle année chinoise, organisée à la légation de Chine à Paris (Gautier J., 1919, p. 153) et, en 1906, à une soirée pour accueillir le prince Zaize ([载泽], 1868-1929).
Judith Gautier est ainsi devenue un témoin important des échanges diplomatiques et culturels de haut niveau entre la France et la Chine. Durant ses rencontres avec les premiers diplomates chinois, notamment avec Zeng Jize ([曾纪泽], 1839-1890), elle porte le titre de visiteuse ou d’invitée. Néanmoins, au fur et à mesure du développement de sa relation avec les membres de la légation de Chine en France, elle tisse des liens amicaux, comme avec Liu Shixun ([刘式训], 1869-1929), et même des amis intimes, tels que Yu Geng ([裕庚], ?-1905) et Sun Baoqi ([孙宝琦], 1867-1931) [Shi Y., 2020]. Étant tous poètes et écrivains, les échanges leur inspirent de nouvelles créations littéraires.
Elle fréquente aussi la légation du Japon, notamment par le biais de ses amis Saionzi Kinmochi ([西園寺公望],1849-1940), futur Premier ministre du pays, qu’elle rencontre peu après l’arrivée du jeune étudiant à Paris en 1871, et surtout Saburō Komyōji (« Mitsouda Komiosi »[光妙寺三郎],1847-1893) qui est attaché à la légation (Gautier J., 1912, p. 59). Saionzi et Saburō contribuent au roman que Gautier intitule L’Usurpateur (Mendès J., 1875), réédité à partir de 1883 sous le titre La Sœur du soleil (Emery E., 2022). Ce roman historique raconte en détail la vie à la cour impériale japonaise tout en faisant revivre les épisodes les plus connus du siège d’Osaka (1615). Elle collabore de nouveau avec ses amis japonais sur Les Poèmes de la libellule (Gautier J., 1885) qui, avec des illustrations par Yamamoto Hosui ([山本芳翠], 1850-1906) font découvrir la poésie japonaise « waka » aux Européens, découverte qui s’avère capitale pour le mouvement symboliste en particulier (Hokenson J., 2004). Gautier continue à participer aux activités culturelles offertes par la légation, comme une cérémonie de thé au début du XXe siècle, évoqué dans un chapitre du livre Le Japon (Gautier J., 1912, p. 59-68).
Il n’y a plus de légation pour la dynastie des Nguyễn après l’invasion française du Tonkin en 1885, mais Gautier rencontre Hàm Nghi (咸宜帝), né Nguyễn Phúc Ưng Lịch (1872-1944) à partir de 1900. Amoureuse de l’« empereur de l’Annam », ses sentiments ne sont pas partagés, ce qui n’empêche pas le développement d’une longue et durable amitié (Richardson J., 1986, p. 203-205 ; Dabat A, 2020, p. 325-326). Elle lui rend visite dans son exil algérien (son seul voyage en dehors de l’Europe) et l'exilé et sa famille lui rend régulièrement visite en France (Richardson J., 1986, p. 203-205, 245, 260 ; Dabat A., 2020). Quoique ce prince en exil refuse de parler de ses expériences au Vietnam, son injuste traitement aux mains des Français sert d’inspiration aux écrits de Gautier ainsi qu’à ses ouvrages artistiques : elle produit des bustes et des médaillons de l’empereur et sa famille et les deux artistes exposent leurs sculptures ou dessins à la Galerie Devambez en 1909 (Dabat A., 2020, p. 332-338).
Un œuvre informé par les arts d’Extrême-Orient
Judith Gautier est connue aujourd’hui comme poète, romancière, dramaturge et artiste mais, à son époque, elle était également appréciée comme critique d’art et chroniqueuse spécialisée dans les arts d’Extrême-Orient. Dès 1864, elle collabore avec des journaux et revues de premier plan (L’Artiste, Le Moniteur universel, Journal officiel) où elle publie des études sur les arts de Chine, du Japon, du Siam et d’Inde sous les pseudonymes « Judith Walter », « F. Chaulnes », ou « Judith Mendès ». De nombreux exemples se trouvent dans la bibliographie : des articles sur la sculpture sur bois, les émaux, jades, ivoires et costumes chinois aussi bien que sur la peinture japonaise (Chaulnes F., 1878). Son appréciation de la collection chinoise du militaire Jean-Louis de Négroni (dates inconnues) en 1864, par exemple, condamne le « pillage » du « Palais du Fils du Ciel » tout en faisant valoir la beauté des objets en jade et cristal de roche et des étoffes qui figurent dans cette collection française rapportée de Chine (Walter J., 1864, p. 188-89). De même, ses longs comptes rendus des Expositions universelles de 1867 et 1878 pour Le Moniteur universel font découvrir au grand public la peinture et la sculpture de ces pays (Walter J., 1867 ; Chaulnes F., 1878) lorsque ses écrits sur la musique chinoise sont fondés sur de sérieuses recherches (Shi Y., 2020).
Mais à partir des années 1880, Gautier semble se laisser emporter par la vogue commerciale pour les histoires de « princesses » (Viegnes M., 2011). Influencée autant par ses amitiés avec Victor Hugo (1802-1885) et Richard Wagner (1813-1883) – tous deux férus de mythologie – que par de nouvelles opportunités commerciales, elle publie de plus en plus de textes imprégnés de l’« exotisme » de l’Extrême-Orient. Elle republie ses vieux articles de presse dans des anthologies avec de nouveaux titres mystérieux pour accrocher le public : Les Peuples étranges (Gautier J., 1879) – où elle évoque des traditions chinoises, japonaises et cochinchinoises – Les Musiques bizarres à l’Exposition de 1900 – où elle décrit des spectacles chinois, javanais, indochinois, japonais, égyptiens et malgaches (Gautier J., 1900). Les Princesses d’amour (Gautier J., 1900) évoquent le monde des courtisanes japonaises si connu en France grâce aux estampes ukiyo-e devenues à la mode à Paris à partir de l’exposition des estampes japonaises à l’École des beaux-arts en 1891. Ses livres illustrés pour enfants En Chine (Merveilleuses Histoires) ou Le Japon (Merveilleuses Histoires) juxtaposent des éléments historiques, linguistiques, culturels et religieux avec des chapitres portant sur l’art, la musique, la mode et la littérature (Gautier J., 1911 ; Gautier J., 1912).
C’est surtout au théâtre que Gautier fait valoir sa connaissance de l’art et de la musique asiatiques : des lettres envoyées au musée Guimet montrent à quel point elle cherche à faire figurer sur scène des objets d’art authentiques, que ce soit des costumes ou des instruments de musique qu’elle emprunte ou copie (MNAAG, lettre de Gautier au musée Guimet du 7 novembre 1897). Mais les nombreuses pièces de théâtre « chinois », « japonais » ou « annamites » qu’elle fait monter au théâtre de l’Odéon, au Vaudeville et dans des résidences privées de 1880 à 1918 ont dû bien compliquer la vision de l’Extrême-Orient des Parisiens : si les objets d’art et les costumes sur scène étaient plus ou moins authentiques, quoi dire des scénarios adaptés des histoires chinoises ou japonaises et joués en français par des Européens habillés en « Orientaux » ? La Marchande de sourires, pièce dite « chinoise » qu’elle adapte pour l’Odéon en 1888 en transposant l’intrigue au Japon, fournit un bon exemple de la confusion causée par ce genre de mélange. Les costumes et scènes, photographiés par l’Atelier Nadar et conservés à la Bibliothèque nationale, nous permettent d’évaluer les effets qu’auraient pu produire ce genre de spectacle (Atelier Nadar, 1888).
Et que dire des stéréotypes disséminés par les titres « orientaux » interchangeables de ces pièces ? Le Ramier blanc (pièce chinoise) joué à l’hôtel de Poilly en 1880 (Richardson J., 1986, p. 139) ; La Tunique merveilleuse (pièce chinoise) à l’Odéon en 1899 (Gautier J., 1904) ; Princesses d’amour (adaptation de son recueil éponyme de contes « japonais » au Vaudeville en 1908 ; Richardson J., 1986, p. 288) ; L’Avare chinoise (pièce chinoise) à l’Odéon en 1908 (Gautier J., 1919) ; Embûche fleurie au théâtre Michel en 1911 (Richardson J., 1986, p. 233, 281) ; La Fille du ciel (« drame chinois » co-écrit avec Pierre Loti, 1850-1923 ; Gautier J., 1911) ; L’Apsara (pièce hindoue ; Richardson J., 1986, p. 288) ; Les Portes rouges (« pièce annamite » ; Richardson J., 1986, p. 279). Les cinq volumes du Japon et la Chine dans les œuvres de Judith Gautier, collection dirigée par Brigitte Koyama-Richard, fournit une anthologie des plus importants textes de Gautier sans prétendre à l’exhaustivité. Ses Œuvres complètes, collection dirigée par Yvan Daniel chez Classiques Garnier, sont en cours ; Daniel et ses collaborateurs mettront peut-être plus d’emphase sur son importante œuvre théâtrale et l’influence que ses spectacles auraient exercée sur le public occidental.
Monde de rêve
Le parcours de recherche de Judith Gautier est caractérisé par son « esprit libre », comme elle le dit lors de son élection à l’Académie Goncourt en 1910 (Gautier J., Le Temps, 1910). Elle cherche une autonomie, une identité distinctive. Si elle est d’abord reconnue pour des publications inspirées par la poésie chinoise ou japonaise ou pour des chroniques consacrées à l’histoire ou la culture des pays de l’Extrême-Orient, elle abandonne progressivement l’ethnographique et l’histoire pour produire – à partir des années 1880 – des traductions ou des réécritures de textes chinois, japonais ou indiens. Comme pour ses pièces de théâtre, les titres de certains de ses ouvrages en prose donnent un sens du « parfum » exotique qu’elle diffuse autour des cultures qu’elle a d’abord cherché à rendre familières. Dans Fleurs d’Orient : nouvelles historiques (Gautier J., 1893), par exemple, on mélange des contes égyptiens, vietnamiens, chinois et japonais, comme c’est également le cas dans Khou-n-ato-nou(fragments d’un papyrus)et diverses nouvelles (Gautier J., 1898) ou Le Paravent de soie et de l’or (Gautier J., 1904).
Il ne faudrait pas forcément interpréter la profusion de princesses et de figures mythologiques qui peuplent les écrits de Gautier à partir des années 1880 comme une réflexion de ses connaissances de réelles pratiques culturelles : séparée de son époux et toujours à court d’argent, elle profite aussi d’un moment où les réformes pédagogiques de la IIIe République créent une demande pour des lectures de jeunesse. Elle gagne sa vie en adaptant les histoires légendaires qu’elle a entendues, suscitant l’imagination de ses lecteurs pour le voyage et la géographie, contribuant ainsi sans le vouloir à l’expansion coloniale. Son amitié, puis sa cohabitation avec la jeune Suzanne Meyer-Zundel (1882-1971), passionnée par les légendes européennes et asiatiques, comme l’avaient été auparavant ses amis Hugo et Wagner, a dû encourager cette production mythologique. Meyer-Zundel partage aussi son enthousiasme pour l’art chinois et japonais : elle installe sa propre petite collection de meubles japonais et chinois dans leur appartement parisien (Étude KL, 1918).
Constitution de la collection
La collection de Judith Gautier, comme celle de beaucoup d’artistes, se compose de cadeaux, offerts par des amis américains, européens, japonais, chinois, vietnamiens et perses. On peut citer, par exemple, une bague en or avec un gros diamant offert par le schah de Perse Nassar Eddin (1831-1896 ; Étude KL, 1918) ; une cithare de la part d’Hàm Nghi ; ou un éventail offert par le prince chinois Zaize. Cet éventail est illustré d’un poème écrit par « Soueng-Pao-Ki » (Sun Baoqi [孙宝琦], 1867-1931) auquel Gautier dédicace un poème (Shi Y., 2020). Robert de Montesquiou, baron du Fezensac (1855-1921), lui offre un parasol japonais (BnF N.a.fr. 15248, fo 41-42), qu'elle expose au Pré des Oiseaux, sa villégiature bretonne.
La villa Le Pré des Oiseaux, située à la plage de Saint-Énogat à Dinard, est acquise par Gautier et son époux, Catulle Mendès, en 1877. Mendès la lui cède lors de leur séparation le 13 juillet 1878 (Étude KL, 1917). Elle y accueille de nombreux amis artistes et ils remercient leur hôtesse de son hospitalité en lui faisant des cadeaux. John Singer Sargent (1856-1925) lui laisse un beau portrait aujourd'hui dans la collection du Detroit Institute of Art (USA) et Yamamoto Hosui ([山本芳翠], 1850-1906), qui a séjourné dans la villa en 1883, produit des peintures murales toujours conservées dans un petit pavillon dans le jardin (Takashina E, 2004; Bretania.brzh, 2021). C’est lui qui illustre Les Poèmes de la libellule en 1885. Ce peintre japonais, arrivé pour étudier avec Jean-Léon Gérôme (1824-1904) lors de l’Exposition de 1878, était un des plus importants « passeurs d'Asie » ; ses contributions aux arts graphiques françaises et à la peinture française et japonaise exercent, comme le montre Takashina (Takashina E, 2003-2004), une importante influence sur les artistes des deux pays. Yamamoto ouvre une école d'art, la « Seikokan », à son retour à Tokyo en 1887. Son portrait à l’huile de Gautier est censé être le premier d’une Européenne au Japon (Kanazawa K. 1990, p. 77)
D’autres éléments de la collection asiatique de Judith Gautier sont plus difficiles à saisir. Nous savons qu’elle tenait beaucoup à ses œuvres japonaises, qui voyageaient avec elle : Suzanne Meyer-Zundel, la compagne et l’héritière de Gautier, se souvient du soin avec lequel elles « décrochaient » les « kakemonos » japonais et rangeaient les « bibelots précieux » à la fin de chaque saison afin de les transporter à Paris (Meyer-Zundel S., 1969, p. 39). Malheureusement, l'inventaire de l’appartement parisien fait après le décès de Gautier, en mars 1918 – à un moment où la guerre l’avait tenue éloignée de Paris depuis quatre ans (Meyer-Zundel S., 1969, p. 194) – fournit peu de détails sur une collection accumulée pendant quarante ans. On n'a malheureusement pas fait d'inventaire de la villa du Pré des Oiseaux, léguée avec ses meubles et objets à Meyer-Zundel (Étude KL, 1918).
Parmi les objets inventoriés à Paris dans l’appartement au cinquième étage du 30, rue Washington, on reconnaît le lit de Théophile Gautier (« un lit à colonnes torses en chêne sculpté et literie » prisé 150 francs), mais les appréciations concernant (par exemple) un lot de « quinze pièces peintures et aquarelles », « un plat en cuivre, un panier, un Samovar cuivre » et « un vase en faïence cuivre », le tout prisé 100 francs, nous laisse sur notre faim, surtout quand nous savons que Judith Gautier possédait des tableaux de Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), Paul Baudry (1828-1886), René Gérin (1862-1895 ; une scène de Tannhaüser), Singer-Sargent, un médaillon de Claudius Popelin (1825-1892), des portraits autographiés de Franz Liszt (1811-1886) et de Wagner et Hugo (Guillemot M, 1888; Meyer-Zundel S., 1969, p. 22). Les « six vases Chine et menus objets d’étagère, une galerie de foyer, un coffre, un candélabre, une applique, un ivoire japonais » auraient-ils une valeur esthétique ou patrimoniale plus grande que les 250 francs reconnus par le commissaire-priseur ? Que dire des « 100 volumes reliés et brochés » (10 francs) et les « 200 volumes brochés dont le Larousse » prisés avec la vitrine en acajou et un casier (500 francs) ? Membre de l'Académie Goncourt et amie de trois générations d’écrivains et artistes, Judith Gautier possédaient de rares premières éditions et de livres d’artistes.
Les souvenirs laissés par de nombreux visiteurs dans ce petit appartement sur une période de 30 ans nous aideraient à mieux cerner la collection s’ils n’étaient pas quasiment tous prédéterminés par les écrits « orientalisants » de Gautier. Henri de Régnier, par exemple, met l’emphase en 1892 sur ses aspects « Moyen-Orient » : « Et ce salon bizarre, qui semble le boudoir d'une voiture de saltimbanques, où un quartier d'orange offert par Judith, avec son air de juive d’Orient, prend un air exotique ? Et Judith elle-même est bien singulière ! Il y a comme une fée des mille et une nuits captive dans ce corps » (cité par Laisney V., 2020, p. 62). Les chercheurs qui ont mis en anthologie ce genre de portraits littéraires (Richardson J., 1986 ; Laisney V., 2020 ; BnF recueil factice, s.d.) nous permettent de repérer les nombreuses contradictions, ce qui nous met en garde contre une lecture « au pied de la lettre » des textes qui sont, essentiellement, de belles peintures en prose. Comme Judith Gautier « incarne l'Orient » pour ses contemporains (Horschani I, 2020, p. 163), leurs portraits littéraires finissent par cacher le vrai contenu de ce modeste appartement parisien derrière une fumée d’encens orientaliste qui sert de métonymie pour son œuvre. Ce genre de « mystère » poétique (Gautier devenue l’oracle d’un « temple de souvenirs », Laisney V., 2020, p. 53-60) rend plus intéressant ce petit appartement sous les toits. « Un jardin suspendu, sous le ciel de la “moderne Babylone” », une « terrasse carthaginoise », comme Régnier l’évoque l’appartement en 1930 (cité dans Laisney V., 2020, p. 71), rend beaucoup plus honneur à Judith Gautier que la description réaliste de Léo Larguier de 1929 : « Une grosse dame en peignoir de soie crème » qui arrose les plantes sur son balcon (Laisney V., 2020, p. 70).
Malgré de nombreuses références à un appartement bourré de bibelots, une photographie de l’appartement (celle qui accompagne cette notice) ne ressemble nullement à une « voiture de saltimbanques » (BnF, recueil factice, fo 11). Gautier s'allonge sur le canapé, accompagnée de (selon la légende) Bibelot, le chien « japonais » qui porte une petite veste en soie, et Satan, le chat noir. Cette photo aurait été prise avant 1904, date de parution du Collier des jours (Gautier J., 1904) mentionné dans la légende.
Le salon n’est point, d’ailleurs, encombré pour un salon de cette époque. Cette photo nous permet d’examiner de près les objets qui l’entourent, notamment une série de peintures japonaises accrochées au mur, ainsi que des vases japonais et des tissus à motifs indiens. Les visiteurs qui seraient venus plus tard – notamment dans les années précédant la Première Guerre mondiale – auraient probablement décrit des objets appartenant à Suzanne Meyer-Zundel, devenue si discrètement la colocataire de Gautier que les notaires sont pris au dépourvu. Lors de l’inventaire de 1918, ils s'étonnent de Meyer-Zundel, qui identifie les objets d'art asiatiques qui lui appartiennent : « Un panneau chinois bois laqué rouge avec cadre doré », « une potiche chinoise en cloisonné, un brûle-parfum en bronze japonais, un paon en bronze cloisonné », « deux flambeaux chinois » (Étude KL, 1918).
Les documents dont nous disposons aujourd’hui ne permettent pas de parler systématiquement de la « collection » de Judith Gautier, d’autant plus qu’elle n’avait pas les moyens financiers qui lui auraient permis d’acheter de rares objets arts à léguer aux musées. En revanche, celle-ci était tout à fait consciente de la valeur patrimoniale de son « coffre bourré d'autographes », notamment sa correspondance avec la famille Wagner : elle a demandé dans son testament à ce que son exécuteur testamentaire dépose les lettres de Wagner à une bibliothèque (Meyer-Zundel S., 1969, p. 219-228). La correspondance repose maintenant à la Bibliothèque nationale. Meyer-Zundel a également reconnu la valeur patrimoniale des souvenirs familiaux ou amicaux de Judith Gautier et c’est pour cette raison qu'elle a protégé ces objets, allant jusqu'à retenir l’appartement à la rue Washington (Gautier le louait) et la villa du Pré des Oiseaux jusqu’à sa mort en 1971, soit 54 ans après la mort de Gautier. Avant la Seconde Guerre mondiale, la villa de Dinard servait de petit musée dédié à la mémoire de Gautier. Pendant la guerre, Meyer-Zundel défendit la collection : quand la maison fut réquisitionnée par les Allemands elle les obligea à partir. Ceux-ci furent apparemment émus devant cette Française âgée qui défendait avant tant d’énergie les mémentos de leur compatriote Wagner (Descaves P., 1947, p. 6).
Si Judith Gautier a pu faire une collection de tant de « trésors » littéraires et artistiques, c'était grâce à une sociabilité qui la rendait, en quelque sens, collectionneuse et cultivatrice d'artistes et de diplomates. Son intérêt pour la culture d'autrui a contribué énormément à faire avancer les échanges culturels entre la France et l’Extrême-Orient. Elle a créé un espace parisien où les gens de différentes cultures se rencontrent dans l'intimité. Gautier a aidé et encouragé les jeunes Français à apprendre ou à pratiquer le chinois, comme ce fut le cas pour le futur diplomate et traducteur George Soulié de Morant (1878-1955 ; Meyer-Zundel S., 1969, p. 49) ou Jules Jacquemart (1837-1880 ; voir D’Abrigeon P., 2018-2019, p. 87) tout en aidant des étrangers comme Ezra Pound (1885-1972) ou des visiteurs chinois, japonais, vietnamiens ou siamois à mieux connaître les Français. C’est pour cela que Remy de Gourmont appelle son salon « une académie asiatique » et les visiteurs de toute nationalité restent émerveillés par le nombre de gens de milieux variés – ambassadeurs, artistes ou ethnologues – qu'ils côtoient chez elle (Gourmont R., 1922). Il est donc tout naturel que ce soit l’empereur la dynastie des Nguyễn, exilé en Algérie qui envoie l’inscription chinoise figurant sur la tombe de Gautier à Saint-Énogat en Bretagne : 日来天, qui est traduit par Meyer-Zundel comme « La lumière du ciel arrive » (Meyer-Zundel S., 1969, p. 218).
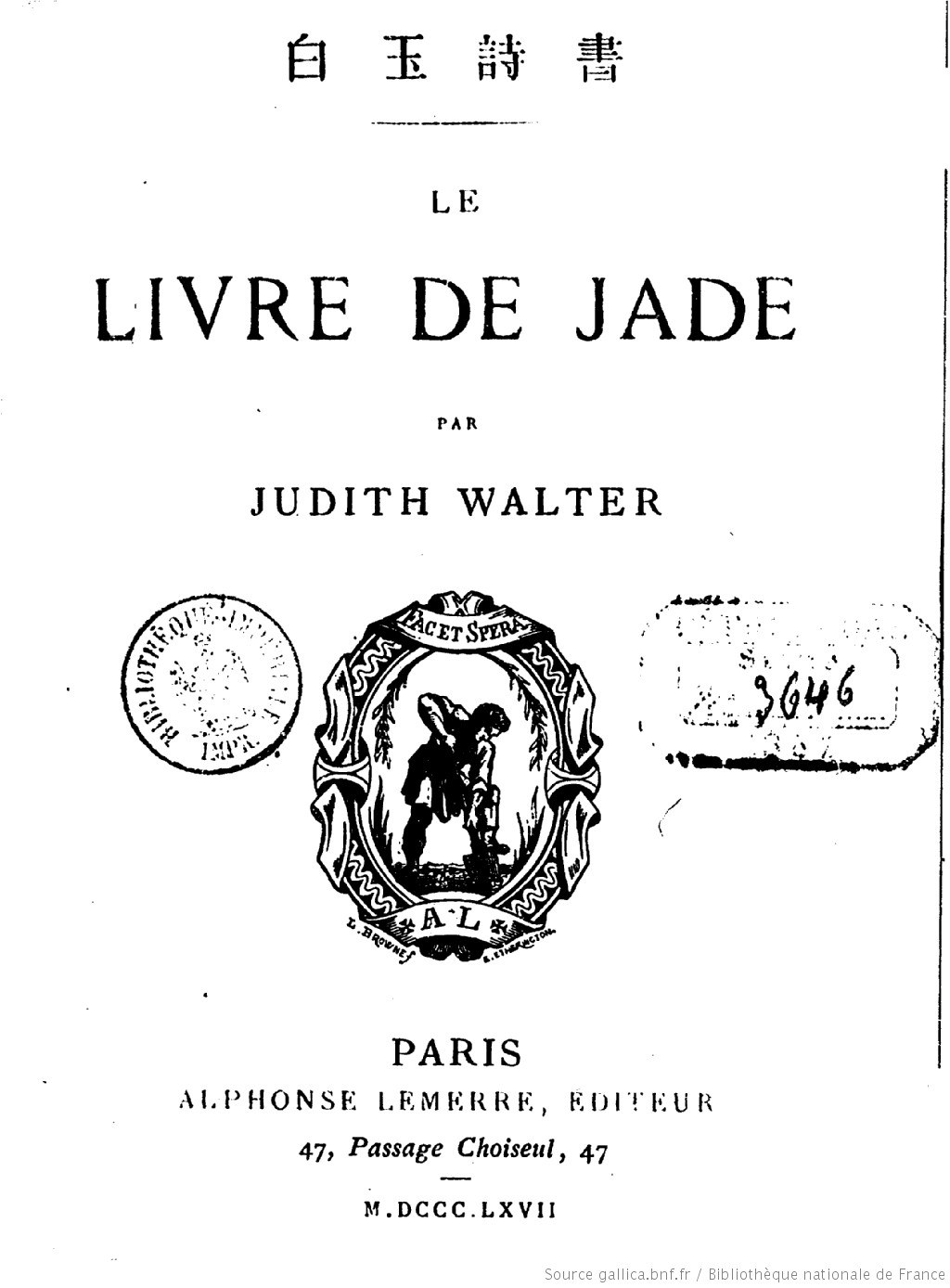
Notices liées
Collection / collection d'une personne
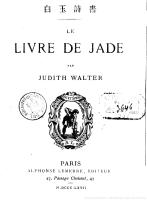
Personne / personne


