
BURNOUF Eugène (FR)
Commentaire biographique
Né le 8 avril 1801 à Paris, Eugène Burnouf est le fils du philologue antiquisant Jean-Louis Burnouf (1775-1844), originaire d’Urville en Normandie, alors commis négociant, puis professeur d’éloquence latine au Collège de France de 1817 à 1826, et de Marie Chavarin (1776-1841), originaire de Maffliers et fille de Joseph, scieur de long (AD 75, 5Mil 114). Formé très tôt par son père à la grammaire du latin et du grec (Wailly N. de, 1852, p. 327), ce dernier fit ses études au Collège royal de Louis-le-Grand. Élève pensionnaire de la section des Archives du royaume à l’École royale des Chartes, en 1822, puis de l’École de droit de Paris (Burnouf-Delisle L., 1891, p. 477), il soutint une thèse de droit romain (Burnouf E., De Re judicata et de rei judiciariae apud Romanos disciplina exercitationem, 1824) sous la direction de Hyacinthe Blondeau (1784-1854) le 6 août 1824. Avocat à la Cour royale de Paris, résident au 13, place de l’École-de-médecine, il se maria le 25 septembre 1826 avec Angélique Poiret (1804-1886), fille de Nicolas, cultivateur (AD 95, p. 143). De leur union naquirent quatre filles : Louise (1828-1905), qui épousa, en 1857, l’historien Léopold Delisle (1826-1910), originaire de Valognes, Amélie (1831-1907), Pauline (1834-1902) et Claire (1842-1894) [AD 75, V3E/N361]. De santé fragile, à l’égal de celle de son grand-père paternel, qui le retint à jamais de voyager en Inde, il épuisa progressivement son corps par un travail intense et continu dans le domaine des langues indo-iraniennes (Wailly N. de, 1852, p. 326). Aussi, malgré des cures aux thermes de Vichy, la lithiase qui le faisait horriblement souffrir dès les années trente (Burnouf-Delisle L., 1891, p. 281 et 302), finit-elle par l’affaiblir complètement. Il mourut le 28 mai 1852 au 21, rue de l’Odéon à Paris et fut inhumé au cimetière du Père-Lachaise (59e division).
La formation à la grammaire comparée que son père lui inculqua très tôt (Wailly N. de, 1852, p. 327 ; Naudet J., 1854, p. 39), dans la droite ligne des travaux de Franz Bopp (1791-1867) et de Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832), les lectures paléographiques à l’École royale des Chartes, les cours de sanskrit professés par Antoine-Léonard Chézy (1776-1832) [Naudet J., 1854, p. 43], qu’il suivit à partir de 1822, l’influence scientifique du linguiste arabisant Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838) [Wailly N. de, 1852, p. 326] finirent par éloigner Eugène Burnouf du Barreau de Paris et l’amener à la science grammaticale des langues orientales pour laquelle les manuscrits qui avaient été déposés à la Bibliothèque royale (Ducœur G., 2021), pour certains depuis le premier quart du XVIIIe siècle, offraient la plus belle des opportunités. Celle-ci fut également rendue possible grâce notamment au travail préliminaire d’Alexander Hamilton (1762-1824), membre de la Société asiatique de Calcutta, qui, de retour des Indes orientales et de passage à Paris, y enseigna le sanskrit et y publia, en 1807, le Catalogue des manuscrits sanskrits de la Bibliothèque impériale.
Présent lors de la fondation de la Société asiatique de Paris, en 1822, Eugène Burnouf fut très vite l’un des pionniers européens dans plusieurs domaines de recherche : le déchiffrement des langues iraniennes préislamiques et de la langue bouddhique pālie permettant des avancées dans la grammaire comparée indo-européenne, l’étude du Veda et de la littérature sanskrite postvédique ainsi que la restitution de l’histoire du bouddhisme indien à partir de la lecture de manuscrits sanskrits népalais (Barthélémy Saint-Hilaire J., 1852). Secrétaire adjoint, en 1826, puis, secrétaire, en 1829, de la Société asiatique de Paris, professeur de grammaire à l’École normale de Paris de 1830 à 1833 (Mohl J., 1852), membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1832 (Gazette des écoles, 1832, p. 4), il devint professeur de « langue et littérature sanskrites » au Collège de France en 1833. Inspecteur de la typographie orientale à l’Imprimerie royale après S. de Sacy, en 1838 (Mohl J., 1852), il fut élu, quelques jours avant sa mort, secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et des belles-lettres (Naudet J., 1854, p. 39-61). Tout au long de sa carrière, il acheta, sur ses deniers personnels, un grand nombre de copies de manuscrits parsis et indiens en provenance de Calcutta, Bombay et Madras et recopia lui-même certains textes avestiques et sanskrits lors d’un séjour à Oxford et à Londres d’avril à août 1835 (Burnouf-Delisle L., 1891, p. 190-274).
Le premier travail notable qu’il publia, en collaboration avec l’indianiste norvégien Christian Lassen (1800-1876), fut l’Essai sur le pali ou langue sacrée de la presqu’île au-delà du Gange en 1826 (Burnouf E., Lassen C., 1826). À partir des quelques travaux fort succincts de ses prédécesseurs, de la lecture de cinq manuscrits palis siamois et birmans, conservés à la Bibliothèque royale de Paris, il put déchiffrer les différentes graphies et comparer la langue pālie au sanskrit afin d’en comprendre le sens et d’exposer ainsi les particularismes grammaticaux de cette ancienne langue bouddhique.
La deuxième recherche dans laquelle il s’illustra fut l’édition du Vendidad Sadé, de 1829 à 1843, d’après un manuscrit de la Bibliothèque royale et surtout l’analyse sémantique de la langue avestique dans son Commentaire sur le Yaçna, à partir de quatre manuscrits conservés à ladite bibliothèque et d’une version sanskrite publiée en 1833. Dès 1836, Burnouf entretint une correspondance régulière avec le Parsi Manockjee Cursetjee (1808-1887) à qui il demanda de lui faire copier et de lui envoyer à ses frais personnels un grand nombre de textes mazdéens accompagnés d’une traduction sanskrite (Feer L., 1899, p. 128).
Outre ses cours au Collège de France sur le Ṛgveda et plusieurs traductions d’extraits de l’Hitopadeśa (1823), du Mārkaṇḍeya Purāṇa (1824) ou du Padma Purāṇa (1825), Burnouf entreprit la traduction du Bhāgavata Purāṇa (BhP I-IX, 1840-1847), à partir de trois manuscrits de la Bibliothèque royale et du manuscrit de Duvaucel de la Société asiatique de Paris (Burnouf E., 1840, p. CLIX-CLXI), traduction qu’il ne put malheureusement achever, mais qui le fut par ses élèves (BhP X-XII, 1881). Enfin, fort de ses connaissances des sources pālies et de l’arrivée, à partir de 1836, de copies de manuscrits sanskrits bouddhiques en provenance du Népal (Filliozat J., 1941, p. X), envoyées par Brian Houghton Hodgson (1801-1894), Burnouf tenta de restituer l’histoire des origines indiennes du bouddhisme (Introduction à l’histoire du buddhisme indien, 1844) et traduisit le Saddharmapuṇḍarīka (Le Lotus de la bonne loi) accompagné de commentaires ; œuvre qui, alors mise sous presse, fut imprimée cinq mois seulement après sa mort, sous l’œil vigilant de son collègue et ami iranologue Jules Mohl (1800-1876).
Continuateur de l’œuvre d’Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805) sur le déchiffrement des textes mazdéens, Eugène Burnouf, dont la rigueur philologique et la méthode historico-critique assurèrent à la science quelques-unes de ses plus belles avancées dans le domaine de l’histoire des religions au cours de la première moitié du XIXe siècle, peut aujourd’hui être considéré, en Europe, comme le fondateur de la bouddhologie et l’initiateur de l’histoire comparée des religions dont son élève, Max Müller (1823-1900), qui poursuivit ses travaux sur le Ṛgveda à sa demande, deviendra le fondateur (Ducœur G., 2013).

CC0
Constitution de la collection
Après la mort d’Eugène Burnouf, la collection des manuscrits qu’il avait achetés ou reçus en don fut acquise par la Bibliothèque impériale et forma le « Fonds Burnouf » en 1854 (Filliozat J., 1941, p. XII). Cette collection est donc toujours actuellement conservée à la Bibliothèque nationale de France. Néanmoins, au cours de son histoire, les cotes ont été modifiées lors d’inventaires successifs comme en témoignent les différents catalogues du département des Manuscrits orientaux (Blochet E., 1900 ; Cabaton A., 1907 et 1908 ; Filliozat J., 1941 et 1970).
Les difficultés que Burnouf rencontra lorsqu’il commença à travailler sur les manuscrits indiens, pour certains conservés à la Bibliothèque royale depuis la première moitié du XVIIIe siècle, souvent en écritures de l’Inde du Sud où œuvraient les missionnaires chrétiens, l’amenèrent rapidement à entreprendre l’acquisition de nouvelles copies en écriture devanāgarī aussi bien pour la Société asiatique de Paris que pour lui-même (Ducoeur G., 2021). À sa mort, sa collection personnelle comptait un peu plus de deux cents manuscrits, pour beaucoup sur papier indien et datant des XVIIIe et XIXe siècles, en provenance soit d’Asie du Sud soit de collections d’orientalistes européens. Elle était composée de textes en avestique et en pehlvi (7), en sanskrit (123) et en pāli (22) ainsi qu’en dialectes indiens (42), voire en birman (3), siamois (3) ou singhalais (10). Pour l’essentiel, il s’agit de textes religieux – mazdéens, védiques et bouddhiques –, de leurs commentaires, ainsi que de quelques traités de grammaire, d’astronomie et de médecine. Ceci induit que la littérature épique (Mahābhārata et Rāmāyaṇa) en est quasiment absente et que le seul manuscrit purāṇique complet est celui du Bhāgavata et du commentaire de Śrīdhara Svāmin (BnF, sanscrit 463-475). Cette copie de 3 139 pages, réalisée sur papier indien à Bénarès entre 1839 et 1840, lui fut offerte par Saint-Hubert Theroulde de retour des Indes. D’excellente facture, Burnouf la prit en considération pour sa traduction du Bhāgavata Purāṇa à partir du livre IV (Burnouf E., 1844b, p. II-III). L’ensemble de cette collection reflète donc les domaines d’étude dans lesquels s’illustra Burnouf, à savoir les études avestiques fondées sur la comparaison avec le Veda et surtout l’histoire du bouddhisme indien, aussi bien des écoles anciennes (sthaviravāda et mahāsāṃghika) que du Mahāyāṇa. L’ensemble de cette importante collection personnelle datant de la première moitié du XIXe siècle a été inventorié dans plusieurs catalogues (Anonyme, 1854 ; Blochet E., 1900 ; Cabaton A., 1907 et 1908 ; Filliozat J., 1941 et 1970).
Après l’édition de son Commentaire sur le Yaçna en 1833, réalisé à partir des manuscrits de la Bibliothèque royale, Burnouf obtint par l’intermédiaire de Manockjee Cursetjee (1808-1887) plusieurs manuscrits des textes avestiques (Feer L., 1899, p. 125-147). Néanmoins, afin d’en faciliter la lecture, il lui demanda soit une transcription en devanāgarī, soit une traduction en sanskrit, notamment pour le Vidēvdāt. En 1838, Manockjee Cursetjee lui envoya un manuscrit contenant les Yašt (Blochet E., 1900, p. 57) en avestique et en sanskrit et, en 1841, le Mīnōkhired (Blochet E., 1900, p. 73) en pehlvi accompagné de sa traduction sanskrite réalisée par Nairiūsaṅgha (XVe siècle). Après avoir déterminé la parenté linguistique entre les langues avestique et ṛgvédique, Burnouf saisit que le déchiffrement de la langue avestique ne pouvait se faire sans un travail de comparaison avec le lexique védique. C’est pourquoi, il chercha également à obtenir des manuscrits du Veda, notamment par l’intermédiaire de John Stevenson (1798-1858) et de James Prinsep (1799-1840) (Feer L., 1899, p. 140 et 151 ; Burnouf-Delisle L., 1891, p. 312 et 316). Ainsi s’était-il procuré, d’une part, une version du Ṛgveda sous sa forme padapāṭha en huit volumes, datant de 1794 (BnF sanscrit 199-206), et, d’autre part, le commentaire de Sāyaṇa (XIVe siècle) ou Ṛgvedabhāṣya qui fut copié à Bombay en 1838 pour lui (BnF, sanscrit 216-218). À l’aide de ces matériaux de lecture plus aisée que celle de l’écriture telinga sur ôle (Burnouf E., 1833, p. 161), il put poursuivre ses Études sur la langue et les textes zends et préparer, dans de meilleures conditions, ses cours au Collège de France sur la littérature védique.
Quant aux manuscrits bouddhiques en pāli et en sanskrit, ils furent acquis par Burnouf après l’intérêt qu’il porta à déchiffrer le pāli avec Chr. Lassen. Le 2 juin 1833, par exemple, il acheta un manuscrit sur ôles du Dīghanikāya au libraire londonien William Straker (BnF, pali 46, verso de l’ais final). S’il s’était également procuré des textes du Vinayapiṭaka tel le Pātimokkha (BnF, pali 9), son intérêt se porta aussi sur les récits historiques comme le Commentaire du Mahāvaṃsa ou Mahāvaṃsaṭīkā (BnF, pali 367), copie datant de 1837, ou encore l’histoire des stūpa bouddhiques, Thūpavaṃsa (BnF, pali 368). Mais ce furent assurément les liens qu’il tissa avec Brian Houghton Hodgson (1800-1894), à partir de 1835, qui lui permirent d’acheter une magnifique collection de manuscrits bouddhiques en langue sanskrite, parfois teintée de prākṛtismes, tracée en caractères népalais (Feer L., 1899, 147-179). Parmi ces derniers, dont la lecture lui permit de rédiger son Introduction à l’histoire du buddhisme indien, notons le Lalitavistara (BnF, sanscrit 97-98) envoyé de Katmandou par Hodgson en 1836, l’Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (BnF, sanscrit 11-12), en 1837, le Mahāvastu (BnF, sanscrit 87-89), en 1841, et surtout deux manuscrits du Saddharmapuṇḍarīka (BnF,, sanscrit 138-139 et 140-141) à partir desquels, collationnés avec ceux de la Société asiatique de Paris et de la British Library, il entreprit sa traduction commentée, Le Lotus de la bonne loi, publiée en 1852.
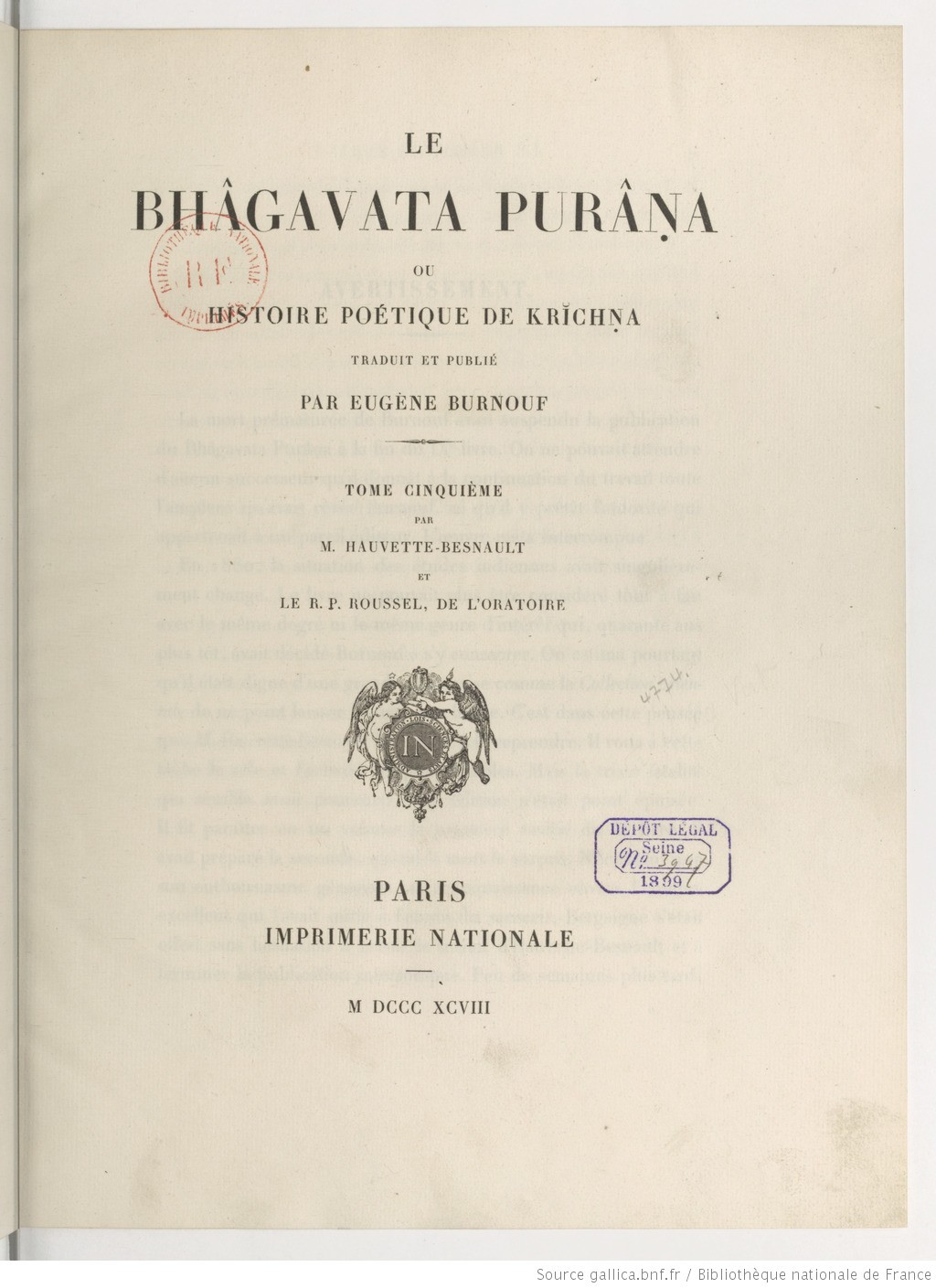
Notices liées
Collection / collection d'une personne

Personne / personne

