
COLLIN Raphaël (FR)
Commentaire biographique
La carrière d’artiste du collectionneur d’art asiatique Louis-Joseph-Raphaël Collin est bien connue. Peintre fameux en son temps, il fut plusieurs fois primé au Salon et ses œuvres sont nombreuses dans les collections publiques.
Né à Paris en 1850 de parents lorrains, il passe ses jeunes années à Verdun, où il se lie d’amitié avec Jules Bastien-Lepage (1848-1884). Sa famille revenue à la capitale, il se forme quelques mois dans l’atelier de William Bouguereau (1825-1905) avant de rejoindre Bastien-Lepage, Fernand Cormon (1845-1924) et Benjamin-Constant (1845-1902) en 1868 dans la section de peinture de l’École des beaux-arts, où il est l’élève d’Alexandre Cabanel (1823-1889). Devenu professeur à son tour, il attire par son enseignement à l’académie Colarossi des étudiants originaires du Canada, des États-Unis et du Japon, dont les futurs pionniers de la peinture moderne dans ce pays Fuji Masazo (1853-1916), Seiki Kuroda (1866-1924), Kume Keiichirō (1866-1934), Wada Eisaku (1874-1959) et Okada Saburōsuke (1869-1939).
Raphaël Collin est, parallèlement, illustrateur de livres et décorateur d’édifices publics. En 1880, il reçoit les commandes de deux toiles de grand format destinées au foyer du théâtre municipal de Belfort puis, en 1886-1888, des panneaux décoratifs Fin d’été, pour la salle à manger de l’appartement de fonction du recteur de la Sorbonne, et La Poésie, encore en place dans le salon des Lettres de l’hôtel de ville de Paris (1890-1893). Il réalise des décors pour les foyers des théâtres de l’Odéon et de l’Opéra-Comique de 1894 à 1899, puis le plafond de la préfecture de la Haute-Vienne. Vers 1912, il entame la décoration, disparue, de la salle des mariages de la mairie de Fontenay-aux-Roses, commune où il possède une résidence secondaire lui permettant de se livrer à la peinture de plein air. Portraitiste de la bourgeoisie mondaine, il développe également une importante clientèle privée. Nous connaissons enfin plusieurs grands plats en faïence ornés de sa main, fruit d’une collaboration avec le céramiste Théodore Deck (1823-1891) de 1872 à 1889.
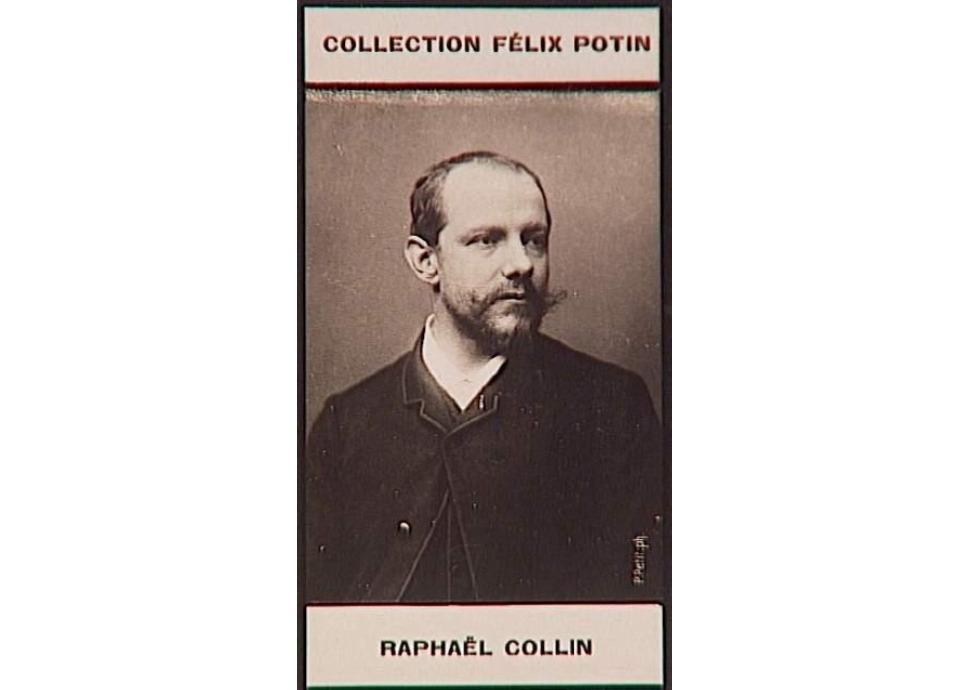
Domaine public / CC BY-SA 3.0
Constitution de la collection
En l’absence de vente après décès et de catalogue associé, le profil de collectionneur de Raphaël Collin ne peut qu’être restitué à partir de sources éparses. Le peintre, qui n’a pas fait le voyage en Asie, attribue au marchand Hayashi Tadamasa (1853-1906) sa découverte de la civilisation japonaise. Arrivé en France en 1878, ce dernier se spécialise en effet dans le commerce d’antiquités asiatiques. Contribuant à l’essor du japonisme, sa galerie parisienne est très fréquentée par les amateurs pendant une vingtaine d’années à compter de 1884. La préface rédigée par Collin pour le catalogue de la vente posthume de la collection Hayashi constitue un précieux témoignage sur la formation de son propre goût : « J’ai fait la connaissance de Tadamasa Hayashi vers 1884 […]. Personnellement, mes études de nu en plein air trouvèrent faveur à ses yeux, et il exprima le désir de posséder plusieurs de mes peintures les plus importantes. En contrepartie, Hayashi nous initia, d’une manière exquise, à ce monde inconnu et plein de merveilles dont il accumulait les précieuses reliques dans son appartement de la rue de la Victoire, et où chaque visite que nous lui rendions nous procurait plaisir et enchantement. Je ne peux traiter avec justice sa manière avec laquelle il nous montrait des poteries fines de la Corée et du Japon, puissamment modelées avec le goût le plus exquis et les formes les plus inspirées dans une argile presque vivante […]. Je rendis maintes visites à Hayashi et je sentis ainsi le charme de ces beaux objets que je rêvais de posséder et que je chéris aujourd’hui » (Illustrated Catalogue…, New York, 1913, p. 13). Dans sa nécrologie du marchand japonais, Raymond Kœchlin (1860-1931) confirme le rôle joué par Hayashi Tadamasa dans la constitution de la collection Collin : « On sait quelles laques et quelles peintures [Hayashi] céda à M. Vever, quelles gardes de sabre à M. Gonse, quelles céramiques à M. R. Colin [sic] » (Kœchlin R., Bulletin de la Société franco-japonaise, décembre 1906, p. 11).
Avant de rencontrer le marchand, Collin était porté vers les antiquités classiques. Une photographie conservée à la Bibliothèque nationale de France datée de 1908 le montre ainsi devant un meuble vitré laissant apparaître des alignements de petites statuettes en terre cuite de type tanagra (BNF, département des Estampes et de la Photographie, EI-13 (7), réf. ROL, 843). Plus tard, ses vitrines abriteront « les plus fins netzkés, les plus élégantes bouteilles à saké […], des midzusachis, des nadsoumés, des tchavans, des tchaïrés, des kogos, ces multiples ustensiles nécessaires à la cérémonie du thé ». Et dans l’atelier voisineront « vases et statuettes de Bizen, faïences de Satsuma aux fines craquelures et les beaux grès coréens […] avec des foukousas brodés […] et des vases de Séto, de Shidoro, de Karatsou, pièces uniques et superbes » (Valet M.-M., 1907, p. 761).
Comme ses contemporains, Raphaël Collin recherche les céramiques, les estampes, les sculptures, les boîtes en laque, les tsuba (gardes de sabre). Les objets, disposés çà et là dans son espace de travail, l’entourent au quotidien : les estampes dans des cartons à dessin, les masques de nô fixés aux murs, les paravents délimitant certaines zones. Nous disposons de rares photographies de son atelier parisien, situé impasse Ronsin, où l’essentiel de la collection semble avoir été conservé, mêlé aux travaux en cours et aux souvenirs de formation. Un cliché d’Edmond Bénard (1838-1907) de la série « Artistes chez eux » constitue vraisemblablement la vue la plus ancienne. Le peintre pose devant un double portrait d’enfants, sans doute Suzanne et Georges, présenté au Salon de 1886. Toiles et bibelots sont savamment disposés autour des chevalets. On devine, accroché au mur, un éventail de type uchiwa et l’on reconnaît un paravent souvent utilisé par l’artiste pour constituer l’arrière-plan de ses portraits. Ainsi, les objets de la collection servent aussi sa peinture. Marie-Madeleine Valet, fidèle contributrice du Bulletin de la Société franco-japonaise de Paris, qui paraît avoir bien connu l’artiste, nous apprend qu’il en use en tant qu’accessoires pour ses modèles : il peint ainsi le portrait de la petite-fille de Pierre Waldeck-Rousseau (1846-1904) serrant dans ses bras une poupée japonaise et celui du jeune Maurice Gautier (1881-1965), un sabre japonais à fourreau de laque corail à la main. Marie-Madeleine Valet témoigne encore d’un usage étonnant : l’artiste installe à côté des modèles des poteries japonaises à l’aide desquelles il établit des rapports de tons et, « dans le grain voluptueux d’un vase de vieux Satsouma, il découvrait autant de beauté, de finesse et d’harmonie que dans les ombres effleurant la douceur d’une belle peau ambrée » (Valet M.-M., 1917, p. 20). L’auteure indique aussi qu’il puise dans ses cartons les « estampes des célèbres maîtres de l’ukiyoyé » dont il admirait les compositions, en tirant un enseignement fécond qu’il partageait avec ses élèves » (Valet M.-M., 1917, p. 21). Ses disciples rentrés au pays le fournissent parfois en objets japonais : « Kume et Kuroda, nous dit Raphaël Collin, sont restés des amis fidèles. Mes anciens élèves m’envoient de temps en temps soit une carte postale, soit un bibelot ou un livre » (Valet M.-M., 1913, p. 111). Kume Keiichirō déclare ainsi avoir rapporté du Japon cinq ou six masques de nô pour les offrir à son maître (Kume Keiichirō Bijutsu, 1916, p. 26). En retour, Raphaël Collin leur offre sans doute les esquisses de ses tableaux, visibles aujourd’hui au musée Kume à Tokyo et au musée municipal de Kagoshima, à la suite du legs de Seiki Kuroda à sa ville natale.
Le peintre assiste probablement aux grandes ventes qui dispersent les collections des amateurs de la première génération. Deux céramiques de sa collection conservent aussi, collées sous leur base, des étiquettes de marchands parisiens, dont celle de Léon et Marie-Madeleine Wannieck, propriétaires depuis 1909 d’une galerie spécialisée dans l’art chinois d’importation directe, rue Saint-Georges à Paris (inv. E 554-417 et E 554-103). En 1894, l’artiste a réuni une collection suffisamment riche et variée pour répondre favorablement à l’appel de Gaston Migeon (1861-1930) : grâce au concours des japonisants de la première heure – Siegfried Bing (1838-1905), Charles Gillot (1853-1903), Michel Manzi (1849-1915), Louis Gonse (1846-1921) et Philippe Burty (1830-1890) entre autres –, le conservateur s’est engagé dans la constitution d’une collection d’art asiatique de qualité destinée au musée du Louvre. Collin fait don de cinq céramiques : un bol raku, un plat coréen du XVIe siècle, un autre « décoré d’une fleur. Décor style Kenzan. XVIIIe siècle », un chaire attribué alors à « l’atelier de Outzi de la fin du XVIIe siècle » et « un kogo de l’atelier de Ohi du XVIIIe siècle », ainsi qu’une tortue de bronze du XVIIe siècle et un « masque en bois laqué blanc, figure calme » du XVIIIe siècle. Ces objets appartiennent désormais aux collections du musée national des Arts asiatiques – Guimet sous les numéros d’inventaire EO 127 à EO 133. Lorsqu’en 1905 Gaston Migeon publie Chefs-d’œuvre d’art japonais, il réserve une place de choix à la collection Collin, retenant pas moins de trente-huit objets appartenant au peintre, reproduits pour la plupart.
Le soutien de Collin aux premières manifestations publiques consacrées à l’art japonais nous vaut aussi de disposer de catalogues d’expositions qui, sans les reproduire toutes, mentionnent les pièces par lui confiées. L’artiste compte parmi les prêteurs des grandes expositions consacrées à l’estampe japonaise par le musée des Arts décoratifs de 1910 à 1914. Nous savons par Kume Keiichirō qu’il a une prédilection pour Harunobu (circa 1725-1770), Kiyonaga (1752-1815) et Hokusai (1760-1849) (Kume Keiichirō, 1916, p. 89). L’artiste, qui a aussi participé aux expositions de gardes de sabre du musée des Arts décoratifs en 1910 et 1911, apparaît également comme un important collectionneur de tsuba. Entre 1910 et 1912, le marquis de Tressan (1877-1914) propose à la rédaction du Bulletin de la Société franco-japonaise de Paris un article sur l’évolution de la garde de sabre au Japon, paru en quatre livraisons (Tressan G., 1910-1912). Les pièces qui l’illustrent appartiennent pour l’essentiel à l’auteur mais, pour les numéros de juin 1910 et juin 1911, quelques-unes proviennent de Raphaël Collin. En 1913, aux côtés des principaux amateurs d’art asiatique, parmi lesquels Raymond Kœchlin, Henri Vever (1854-1942), Alphonse Kann (1870-1948), Madame Langweil (1861-1958), Georges Marteau (1851-1916) et Jacques Doucet (1853-1929), Collin prête, dans le cadre de la quatrième exposition des arts de l’Asie du musée Cernuschi dédiée à l’art bouddhique, deux peintures sur soie, deux masques, trois tsuba, cinq sculptures et quarante et une céramiques liées à la cérémonie du thé. Initié par Hayashi à l’esprit du chanoyu, l’art du thé, et du sadō, la voie du thé, l’artiste semble en effet avoir été séduit par l’essence même de l’esthétique wabi-sabi, ses chawan (bols à thé) et ses mizusashi (récipients à eau froide) incarnant, avec leurs formes rustiques, cette quête de simplicité du bouddhisme zen (Goloubew V. et d’Ardenne de Tizac H., 1913). « Ce qui attirait mon maître Collin parmi les choses japonaises, c’était, hormis les estampes polychromes, les œuvres d’art les plus sobres, à savoir les anciennes céramiques de Seto ou les bols à thé dans le goût coréen ; il se plaisait principalement à rassembler des pièces aux formes simples, sans motif et aux couleurs curieuses » (Kume Keiichirō, 1916, p. 26). Collin côtoie les amateurs lors des ventes publiques et chez les marchands Tadamasa et Bing, notamment à l’occasion des fameux dîners japonais donnés par celui-ci. « Il se rappelait les belles soirées d’autrefois, chez Gillot ou chez Bing, ces soirées inoubliables où l’on devisait entre amis : Montefiore, Duret, Gonse, Clemenceau, Vever, Kœchlin, tous envoûtés par l’art nouvellement révélé, tous communiant dans le même culte du japonisme » (Valet M.-M., 1917, p. 21-22). Entre 1907 et 1912, période pendant laquelle Ichiro Motonō (1862-1918) est ambassadeur du Japon en France, Collin fréquente également les dîners donnés par le diplomate et son épouse, celle-ci revêtant pour l’occasion « l’habit japonais ». Le peintre relate ces soirées dans des lettres adressées à son élève Kume, rentré à Tokyo. Dans l’une d’elles, il décrit un dîner « à la japonaise chez le ministre japonais à Paris, Monsieur Motono, avec d’autres amis des arts du Japon et Hayashi », à l’issue duquel « on a montré des bibelots » (lettre du 8 juillet 1904 parue dans Kofu, no 1, mai 1906). En 1910, Collin rejoint, en tant que membre du conseil d’administration, la Société franco-japonaise de Paris, autre cercle de sociabilité pour tous ces collectionneurs. Cette même année, il accompagne la délégation à Londres pour la visite de la « Japan-British Exhibition », où exposent plusieurs de ses élèves japonais.
Au lendemain de la mort du peintre en 1916, la collection est dispersée. Seul ensemble proposé aux enchères, les tsuba sont vendus à Paris au cours de deux vacations dirigées par l’étude Lair-Dubreuil les 12 et 13 mai 1922, le catalogue de la vente totalisant 520 lots (Lair-Dubreuil F., Flagel L., Portier A., hôtel Drouot, Paris, 1922). Blanche Collin (1854-1917) s’est rapprochée du Louvre au sujet de la collection d’art grec de son frère. En son souvenir, elle fait don d’un masque gagaku (musée Guimet, inv. EO 2426) et cède un paravent à deux feuilles qui lui a appartenu, œuvre du milieu de l’époque d’Edo de l’école Rinpa (musée Guimet, inv. EO 2430). Ces objets rejoignent le noyau des collections japonaises initié par Gaston Migeon, qui connaît le paravent pour l’avoir publié quelques années plus tôt. Sur le point d’accueillir le legs Georges Marteau, le peintre Ernest Laurent (1859-1929) et le conservateur du Louvre Paul Jamot (1863-1939) alertent Henri Focillon (1881-1943), qui dirige alors le musée de Lyon, de la disponibilité de la collection de céramiques extrême-orientales réunie par le peintre. Focillon se rend aussitôt à Paris prendre la mesure de la collection et, sur place, dresse un bref inventaire de plus de quatre cents numéros, après avoir consulté quelques personnalités choisies, parmi lesquelles le peintre et collectionneur danois Charles Madvig (1874-1940). Il conclut rapidement à la nécessité de convaincre le maire de Lyon de l’opportunité de l’acquisition. Dans le rapport qu’il établit à destination de la commission du musée, il écrit : « Il [Raphaël Collin] commença sa collection il y a une quarantaine d’années, où le goût des amateurs allaient plutôt à l’estampe, à la peinture et aux bronzes. Il ne cessa de revenir sur ses acquisitions, pour les épurer. J’ai cru comprendre qu’il avait acheté surtout à Londres, mais il ne négligeait pas les grandes ventes françaises qui lui ont permis de se procurer des œuvres célèbres. C’est ainsi que la collection Collin est parvenue au degré de plénitude et de maturité où nous la voyons » (AM Lyon, 1400 WP 007). Les céramiques sont achetées par le musée de Lyon au prix de 60 000 francs. L’historien d’art, qui s’est lancé dans l’étude de l’art asiatique, a bien mesuré l’importance de cette acquisition, composée de plus de quatre cents pièces du XVIe au XIXe siècle, majoritairement du Japon et de ses différentes régions : Seto, Karatsu, Bizen, Hagi, Shigaraki, Satsuma. Les céramiques japonaises, essentiellement des grès rustiques associés à la cérémonie du thé, quatre-vingt-deux pièces coréennes et cinquante-trois poteries chinoises, dont deux statuettes mingqi, sont livrées au musée au cours de l’été 1917. Des vitrines de Collin, Focillon a également extrait, pour les joindre au lot, un épervier en bois peint égyptien, des céramiques de Jean Carriès (1855-1894), trois pièces de William Lee (1860-1915), un petit vase étrusque en bucchero et neuf verres irisés antiques provenant de Syrie. Ce dernier ensemble rend compte de la diversité de la collection Collin, aussi riche que méconnue.

Domaine public / CC BY-SA 3.0
Notices liées
Collection / collection d'une personne

Personne / personne

