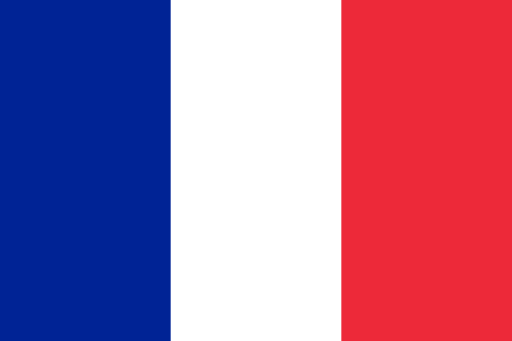Les artistes acteurs de la circulation et du sauvetage des œuvres d’avant-garde
Le rôle des artistes d’avant-garde dans la circulation de leurs oeuvres et celles de leurs amis, en France, aux abords de et pendant la seconde Guerre mondiale, reste largement méconnu. Les chemins que nous allons ici emprunter seront autant de pas de côté par rapport aux canaux habituels du marché de l’époque, hôtel Drouot, intermédiaires de la collaboration, ERR ; ils nous conduiront vers un autre champ et une tout autre éthique des échanges, où les transactions servent généralement la défense et la protection d’un art en voie d’inventer sa propre légitimité et même, nous y reviendrons, les moyens de sa réception institutionnelle. Par temps lourd et vents contraires, quand, dans un changement de paradigme complet, les oeuvres qui peuplent nos actuels musées d’art moderne étaient vilipendées par les personnels de Vichy1 et infameusement considérées comme « dégénérées » par le régime nazi avec la violence que l’on sait2, se firent jour des stratégies de sauvetage et de survie. Il s’agissait finalement rien moins que de résister à la destruction et à son corollaire, l’oubli : oubli d’une effervescence créatrice, d’idéaux, de moments, réseaux, cultures et réalités concrètes. Un tableau que l’on brûle, que l’on perd, qui disparaît avalé par le remous de l’histoire, c’est toujours un monde qui périt.
S’intéresser aux trajets des œuvres, à leurs biographies, à leurs écosystèmes1, informe richement, on le sait aujourd’hui, toute écriture de histoire de l’art qui entend se construire comme un point de croisement entre les pensées, les savoirs et les méthodes — et non seulement la recherche de provenance qui peut parfois se cantonner à une approche strictement sociale, en faisant l’économie du contenu et de la portée artistiques des objets étudiés. « Les biographies de choses peuvent rendre saillant ce qui resterait obscur autrement », écrit Igor Kopytoff2. Les stratégies de défense déployées par les artistes interrogent rien moins que le processus de fabrication de l’histoire de l’art. Elles constituent les artistes en agents et acteurs, non plus en pions de toutes les généalogies modernistes ou en victimes impuissantes de leur moment, ô combien difficile et mortifère fût-il. Elles invitent enfin à changer de focale, conduisant du très petit (niveau micro de l’objet lui-même) au très grand (niveau macro du contexte), et sont par là fécondes d’enseignements aux plans historique, méthodologique, épistémologique.
Au seuil de notre étude, précisons les termes. L’expression même d’ « avant-garde » est devenue minée voire impraticable aux yeux de beaucoup, du fait d’emplois polysémiques et souvent contradictoires au long du vingtième siècle. Elle est pourtant digne d’intérêt, en ce qu’elle recouvre explicitement un versant de la création soudé par des luttes communes, des rêves, des sociabilités ; elle désigne communément les femmes et les hommes issus de Dada et de l’abstraction (dans ses différentes pratiques et acceptions), auxquels ces pages sont consacrées. Nous reprenons la notion pour ce qu’elle fut en son temps, au plus fort des années vingt et encore pendant la période qui nous occupe : non pas un style, ni une époque précise, mais un concept, un mode opératoire, ou, mieux, un projet foncièrement inachevé (et de ce fait toujours actuel). Comme le souligne Patrick de Haas, il ne saurait exister d’avant-garde « historique », car « non seulement ses effets ne sont pas pleinement accomplis, mais elle reste encore largement incomprise dans ses objectifs3. » Si le projet n’est pas daté, les participants de l’avant-garde n’en furent pas moins hommes et femmes de leur temps, et les circulations d’œuvres qu’ils surent organiser jettent en fait les bases de leur propre réception, en particulier au musée, au contraire de lieux communs voulant que l’avant-garde et l’institution s’opposent nécessairement. Ce fut finalement une façon de répondre pied à pied aux forces de la réaction d’abord, de la destruction ensuite.
Portrait de l’artiste en courtier et organisateur de la collection des autres
« Courtier : Le mot est probablement dérivé de l'ancien verbe corre, courre (→ courir) (…) ; désigne la personne chargée de mettre en relation vendeurs et acheteurs moyennant une rémunération, pour des opérations de bourse ou de commerce et, par extension, celle qui joue l'intermédiaire dans une affaire, l'entremetteur (1740)1. » Pour des artistes tels que Marcel Duchamp, Nelly van Doesburg ou, dans une moindre mesure, Sophie Taeuber-Arp, faire du courtage ne fut pas toujours une activité rémunérée (ou alors par un système d’entraide excédant le système de la commission), et, en tout cas, jamais strictement commerciale. Part relativement insoupçonnée de leur œuvre, celle-ci obéit à un impératif moral bien plus vaste, consistant à créer les conditions de la sauvegarde de l’art d’avant-garde, et même de l’éducation du public envers celui-ci. Parce que « la seule façon d’être suivi est de courir plus vite que les autres », selon l’adage dada de Francis Picabia, tous surent agir vite, en chevilles ouvrières des collections les plus importantes de leur époque, sans tenir spécialement à prendre la lumière. Discrets intercesseurs de nos actuels chefs-d’œuvre, ils transformèrent nos façons de voir comme l’idée même de musée d’art moderne ; ou plutôt, ils l’inventèrent.
La guerre n’inaugurant en rien cette pratique tactique, revenons brièvement à son origine. En 1920, à New York, Katherine Dreier, elle-même peintre, mécène, féministe, et bientôt immense collectionneuse, créa en pleine effervescence Dada avec Duchamp et Man Ray la « Société Anonyme — Musée d’art moderne », première occurrence de l’expression, les deux notions étant alors, à chaud si l’on peut dire, sensiblement antithétiques. Conjonction d’individus s’effaçant dans une entité collective supérieure, selon une quête de l’anonymat traversant les pratiques dadas2, et sous une appellation dérivée en toute ironie par Man Ray des structures du commerce (de surcroît redondante en anglais, « Société Anonyme, Inc. » pour Incorporated), alors même que le but était « non commercial3 », elle visait à mettre en circulation des œuvres, des idées, des projets loin d’être acceptés : sa visée était, selon ses statuts, de « faire connaître l’art moderne aux Américains. » La « Société Anonyme — musée d’art moderne » devait rester le prototype des aventures à venir ; rétrospectivement, Katherine Dreier pourra souligner la « grande confusion » suscitée par le MoMA (Museum of Modern Art), créé en 1929 avec des locaux propres, en « s’emparant de son appellation4 ». La Société Anonyme fut pour sa part une structure faite pour et par les artistes, ouverte, vivante, dont on retiendra le spectre résolument international, la clairvoyance et la diversité des choix, les quelques quatre-vingt expositions organisées avant 1939, l’activité intensément et joyeusement pédagogique (nombreuses conférences, y compris dans des lycées où Katherine Dreier allait converser en emmenant avec elle des œuvres de Klee ou Kandinsky, constitution d’une bibliothèque de référence). Musée d’abord situé dans un appartement 19 East 47th Street, puis sans lieu fixe, et sans collection propre à l’origine, la Société anonyme devait bientôt constituer un ensemble sans équivalent que le passage du temps aura rendu à tout point de vue mythique, puisqu’aujourd’hui il n’existe plus, en tant que tel, ayant pour partie été donné à partir de 1941 à l’Université de Yale5 (en tout, plus de mille œuvres par cent quatre-vingt artistes), et la collection personnelle de Katherine Dreier ayant été répartie, outre à Yale, entre plusieurs musées américains, le Guggenheim de New York, le musée de Philadelphie, etc., dispersion qui aura, sans doute, réduit et brouillé la portée d’un tout cohérent. Duchamp en fut d’un bout à l’autre l’artisan.
En influençant et en décidant même de la composition des collections muséales, autant sinon plus que les conservateurs, les artistes d’avant-garde auront su fabriquer la matière même de l’histoire de l’art. Y compris dans l’enthousiasme des débuts de l’URSS, où, avant le reflux général que l’on sait, Kandinsky fut en 1919-1920 le premier directeur du Musée de culture artistique de Moscou et l’organisateur des musées soviétiques (il sera ensuite le vice-président de la Société Anonyme de 1923 à sa mort en 1944) ; au musée de Łódź, en Pologne, où les poète et peintre Jan Brzękowski et Henryk Stazewski avaient constitué, exclusivement par dons et avec le concours du critique Michel Seuphor, une collection d’art abstrait relativement réduite en nombre, mais, en qualité, alors la plus avancée du monde (inaugurée en 1932)6; aux États-Unis où le peintre Albert Eugene Gallatin, membre du groupe Abstraction Création, conseillé notamment par Jean Hélion7, ouvrait en 1927, à New York sur Washington Square, la Gallery devenue Museum of Living Art. On pourrait encore citer, parmi d’autres initiatives, le rôle déterminant de l’artiste Hilla von Rebay auprès de Solomon Guggenheim, dont les efforts devaient aboutir à l’ouverture du Museum of Non Objective Painting en 1939 dans cette même ville (aujourd’hui Guggenheim Museum ; « sans son conseil et ses efforts, M. Guggenheim et son musée n’auraient jamais pu posséder l’une des plus belles et précieuses collections privées qui existent au monde », relevait le peintre et cinéaste dada Hans Richter, qui pourtant n’appréciait qu’à moitié Hilla Rebay8).
En Allemagne, le nazisme porta un coup fatal à l’ouverture et à la richesse sans pareilles des musées de la République de Weimar, dont les collections modernes furent décrochées des cimaises, remisées, bientôt pour partie brûlées, ou vendues notamment en 1939 à Lucerne. À Paris, très conservatrice au plan institutionnel, et où il n’existait aucun musée d’art moderne à proprement parler, les personnels de l’État ne virent pas de nécessité à acquérir ce versant de l’art qui, ailleurs, formait le cœur battant de jeunes musées, malgré une éphémère embellie à la fin du Front populaire que la guerre allait emporter ; c’est toutefois là, comme dans une réalité parallèle, que résidèrent ou passèrent quasiment tous les artistes qui, conseillers, intermédiaires, collectionneurs comme Dreier ou Gallatin, organisèrent les circulations des œuvres d’avant-garde. À l’aube de et pendant la guerre, l’urgence de leurs engagements se fit plus pressante.
Conserver et sauver ce qui peut l’être
En 1935, Sophie Taeuber-Arp fit avec son mari Jean Arp depuis Clamart un triste voyage en Allemagne (« la situation de l’art et des artistes est absolument désespérante », notait-elle), suite auquel elle proposa à Gallatin, qui en avait formulé la demande, des tableaux de Lissitzky, Moholy-Nagy, Kandinsky, Mondrian, que la veuve d’un collectionneur, dont elle ne disait rien de la situation, proposait « très bon marché », car celle-ci ne pouvait plus « les accrocher dans sa maison et ils s’abîment, à la longue, au grenier1 ». Là se trouvait consignée toute l’ambiguïté des temps : à la fois opportunité commerciale dont l’éthique interroge (qu’était-il advenu du mari ?) et sauvetage (les tableaux se dégradent, face au péril, les extraire d’Allemagne garantit leur conservation). Encore faut-il comprendre qui parle pour ne pas mésinterpréter la situation. Citée, à l’instar de tous les dadaïstes, dans une « liste noire2 » – comme elle l’appelait – publiée dans le journal nazi Völkischer Beobachter le 23 février 1933, quatre jours avant l’incendie du Reichstag, opposante au national-socialisme3, Sophie Taeuber-Arp cherchait une issue, pour elle et pour son cercle. D’une grande lucidité, elle ne voyait dès 1935 que deux ultimes refuges pour l’art moderne, « l’Amérique et peut-être la Suisse4 ». Il fallait sauver ce qui pouvait encore l’être.
Entre 1937, quand l’idée de fonder un musée avait émergé, et le 1e juin 1939, date de son ouverture, la collection de Solomon Guggenheim doubla de volume, passant d’environ quatre cents à huit cents œuvres5, la plupart dues à des artistes dits « dégénérés » dans l’Allemagne nazie, et en particulier à Kandinsky, que le magnat du cuivre et son amie Hilla Rebay soutenaient depuis leur visite au Bauhaus en 1929, et cela y compris après son installation difficile à Neuilly fin 1933. En dépit de sa stratégie, commune à de nombreux collectionneurs d’avant-garde, de préférer acheter directement aux artistes, et en dépit aussi du parti qu’il avait pris en 1934, en tant que Juif, de ne plus jamais voyager en Allemagne ni commercer avec ce pays, Guggenheim s’y rendit à nouveau en 1936, où le protégé et le compagnon d’Hilla Rebay, le peintre Rudolf Bauer, lui vendit plusieurs œuvres ; Bauer resterait leur intermédiaire jusqu’à son exil en 1939, après qu’il eut été interné dans un camp. En 1937, Hilla Rebay visita « Entartete Kunst » à Munich où son premier mouvement fut de conseiller à son patron d’acquérir des œuvres de Kandinsky parmi celles exposées (deux tableaux, et douze dessins, sur cinquante-sept œuvres saisies dans les musées allemands, désormais jetées à l’encan et diffamées). Le bruit courait qu’on pouvait les acheter. Pour les Américains, ce serait possible peu après. Lors d’un séjour qu’Hilla Rebay fit à Paris au printemps 1938, elle reçut une lettre du marchand Curt Valentin lui offrant des œuvres issues des collections publiques allemandes, on ignore quelle fut sa réponse6. Solomon Guggenheim acquit en tout cas six Kandinsky, dont un chef-d’œuvre, la toile Montagne bleue (1908-1909, anciennement Staatliche Gemäldegalerie, Dresde), à Berne au printemps 1939, chez Gutekunst und Klipstein ; cette même année, Bauer lui procura une vingtaine d’œuvres de l’artiste, dont « aucune, apparemment, ne venait directement » de Kandinsky7. La collection Guggenheim grandit donc par ce canal, parmi d’autres. Hans Richter, dont l’atelier berlinois avait été massacré par les SA en 1933, et qui n’était plus revenu en Allemagne depuis cette date, Hans Richter qui savait toute la portée du mot « destruction », n’y voyait pas d’ambiguïté morale. Il écrivit à l’été 1939 depuis la France à Hilla Rebay, laquelle devait en 1941 faciliter son propre passage aux États-Unis : « évacuer de l'Europe en péril les œuvres de toutes les périodes importantes, en particulier celles de la dernière génération, qui sont si cruciales pour le futur, les amener en Amérique et planter la "graine de la culture" directement dans le terreau de l'Amérique... C'est une formidable idée... Cet homme (Solomon Guggenheim) est en train de bâtir l’histoire8. »
Ouvrir des musées, garantir la sécurité des œuvres d’avant-garde n’est certes pas le même projet que se les approprier pour en tirer profit sonnant et trébuchant. Ajoutons que ce qui contribua grandement à décider Katherine Dreier, et Marcel Duchamp, à léguer la collection de la Société Anonyme à l’université de Yale à la veille de l’entrée en guerre des États-Unis (le 7 décembre 1941) fut la garantie que le formidable ensemble constitué par eux depuis vingt ans serait évacué dans un abri anti-incendie ad hoc si le pire devait advenir9. Dans le creuset de Dada, ce soi-disant ange noir de la fin de l’art, selon ses détracteurs, sont finalement nées non seulement l’idée mais la réalité même du musée d’art moderne : « il appartient aux historiens pointilleux et aux censeurs tardifs de s’indigner après-coup de ces entorses à la pureté des principes qu’au surplus Dada n’a jamais professés », note justement Robert Lebel10.
Ainsi, est-ce largement la nécessité de conserver qui dicta les choix et finalement le devenir des œuvres, dont la circulation dessine une nouvelle géographie de l’art, comme une nouvelle conception du musée et de la composition de ses collections, à l’aube de et pendant la Deuxième guerre mondiale. Les trajets des objets montrent bien que dès le mitan des années 1930, et non pas tant après 1945, la survie de l’avant-garde se joua, en grande partie, outre-Atlantique.
Peggy Guggenheim à Paris
Nièce de Solomon Guggenheim dont elle n’avait pas l’invraisemblable opulence, tout en restant infiniment aisée1, sans lien et même en opposition avec lui et Hilla Rebay au départ, Peggy Guggenheim mérite notre attention en ce qu’elle rêva ce qu’aucun ni aucune autre n’avait osé : ouvrir un musée dédié à l’avant-garde à Paris, là même où, au fil de la drôle de guerre, elle constitua une collection capable comme bien peu d’autres de résumer l’art moderne des trente dernières années.
Partie de très loin si l’on peut dire, au sens où en 1937 encore, elle était, de son propre aveu, « incapable de reconnaître quoi que ce fût en art2 », Peggy Guggenheim eut pour conseillers Marcel Duchamp d’abord, Nelly van Doesburg ensuite, dont le rôle s’avère plus déterminant qu’on a pu autrefois le supposer3. Musicienne, participante à des soirées dadas aux Pays-Bas lors desquelles elle jouait Satie au piano, avec Kurt Schwitters et son mari Théo, le fondateur du Stijl, mort en 1931, dont elle gardait la mémoire, Nelly van Doesburg était alors en voie de devenir une grande promotrice de l’avant-garde au musée et ailleurs : pense-t-on seulement à l’exposition « Art abstrait », un modèle du genre, qu’elle organisa au Stedelijk Museum d’Amsterdam en 19384 ; ou encore à « Réalités nouvelles », galerie Charpentier à Paris à l’été 1939, sans doute la plus complète exposition d’art abstrait qui se fut jamais tenue dans cette ville5, où furent présentées plusieurs œuvres peu après acquises par son alliée américaine, dont les dessins de Raoul Hausmann6 (alors réfugié à Paris) qui ornent aujourd’hui les murs de la collection Peggy Guggenheim, Palazzo Venier dei Leoni à Venise.
Duchamp avait, peu auparavant, introduit l’enthousiaste héritière auprès du cercle amical dont Nelly van Doesburg et lui faisaient partie en France. Il orienta dès le départ sa collection, entamée vers la fin de 1937 par une sculpture de Arp puis un tableau de Kandinsky ; il pensa aussi et facilita au plan pratique l’excellent programme d’expositions de la galerie Guggenheim Jeune, que celle-ci ouvrit à Londres en janvier 1938 et ferma en juin 1939. À cette date, elle espérait se consacrer à son « musée d’art moderne », nom choisi par le grand historien de l’art britannique Herbert Read qui en conçut le projet interdisciplinaire et, surtout, par une liste qui ne nous est pas parvenue, le choix des artistes à acquérir en vue de former une collection permanente postérieure à 1910. Suite à la déclaration de guerre de la France et de la Grande Bretagne à l’Allemagne, le 3 septembre, qui la trouva en vacances dans le Sud de la France, Peggy Guggenheim choisit de déplacer son utopie à Paris où, selon sa propre légende, elle aurait acheté « un tableau par jour ». Il s’agit en vérité de soixante-dix œuvres majeures, dessins, sculptures et peintures, acquises en huit mois, à partir de la liste de Read révisée par Duchamp et Nelly van Doesburg, et pour l’écrasante majorité auprès des artistes7.
Que tous et toutes se fussent trouvés dans une situation critique, le cas de Nelly van Doesburg seul l’illustre. En février 1939, elle écrivait au seuil du désespoir à la critique suisse Carola Giedion-Welcker pour lui proposer, « comme les choses vont terriblement mal en ce moment », un fort rabais sur le prix d’un tableau de son mari à propos duquel elle avait écrit neuf mois auparavant (1750 F au lieu de 2750F) : « j’ai un besoin urgent d’argent (…) J’ai aussi deux très beaux dessins de Picasso (…), une toile de 1925 par Miró et une autre de Severini, de 1914, que je voudrais vendre (…)8 » Ce dut assurément être un soulagement pour elle de voir Peggy Guggenheim acquérir au plus tard au printemps 1940 son tableau de Severini, un autre de Balla, un troisième d’El Lissitzky, entre autres. Peut-être exista-t-il aussi une forme de sujétion face à celle qui fut en réalité sa « patronne9 », tout en lui facilitant infiniment la vie. Les deux femmes devaient rester longtemps complices.
Grâce à un inventaire réalisé par Nelly van Doesburg avec valeurs d’assurances, probablement en 194010, on sait que Peggy Guggenheim, qui discutait ferme et avait, disons-le, la radinerie de bien des personnes riches, n’en offrit pas moins aux artistes et écrivains tels qu’André Breton (approché via Duchamp11) ou Gabrielle Buffet-Picabia (pour L’Enfant carburateur de Picabia) des prix tout à fait supérieurs à l’ordre de grandeur du dernier recours proposé à Carola Giedion-Welcker. Ces prix contredisent totalement l’idée assez courante selon laquelle les œuvres d’avant-garde n’auraient rien valu alors (comme si, de toute façon, valeurs artistique et financière étaient la même chose) ; jusqu’à la somme assez fantastique pour l’époque de 4000 dollars, soit environ 100 000 euros actuels, pour L’Oiseau dans l’espace à Brancusi qui avait refusé moins, sa cote étant défendue depuis belle lurette par Duchamp et l’écrivain et collectionneur Henri-Pierre Roché qui organisèrent son marché et le tinrent d’entrée de jeu pour l’artiste immense qu’il est devenu de nos jours. L’Américaine payait de surcroît vraisemblablement en dollars, système avantageux tant pour elle, en raison du taux de change, que pour les vendeurs et vendeuses qui craignaient la dévaluation du franc.
Une histoire de l’art en caisses
En avril 1940, Peggy Guggenheim eut un geste d’une exubérance folle au regard de la détérioration de la situation politique : elle loua un grandiose appartement sur la place Vendôme, dans l’idée d’y installer son musée, dont la scénographie fut confiée à Georges Vantongerloo. Mais l’impossible ne fut pas permis. Tous et toutes lui disaient d’évacuer les œuvres. Sur le conseil de Fernand Léger, elle demanda la protection des Musées nationaux, qui, après avoir tergiversé, concédèrent un unique mètre cube au titre de la mise à l’abri des collections privées. Nelly van Doesburg et elles roulèrent dans une caisse les toiles de Mondrian, Klee, Léger, Chirico, Mondrian, etc ; puis arriva la réponse que, finalement, la protection ne leur était pas accordée, l’ensemble ne méritant apparemment pas d’être sauvé1. Maria Jolas (co-fondatrice avec son mari Eugène Jolas de la revue Transition) offrit son château au Nord de Vichy ; là partirent six caisses, dont une spécialement pour L’Oiseau dans l’espace de Brancusi. Peggy Guggenheim et Nelly van Doesburg quittèrent Paris in extremis, trois jours avant que les Allemands entrent dans la ville, direction le lac d’Annecy où le couple Arp les rejoignit.
Vers la fin de l’été, Maria Jolas retourna aux Etats-Unis et Giorgio Joyce, le fils de l’écrivain, envoya les caisses par train à Annecy. Elles y restèrent des jours et des jours sur le quai, Peggy Guggenheim n’ayant pas été avertie de leur arrivée ; par miracle, aucune catastrophe n’eut lieu. Dès lors, comment les mettre en sécurité ? Nelly van Doesburg prit contact avec Andry-Farcy, le directeur du musée de Grenoble, qui abritait alors la meilleure collection d’art moderne de France, et qui fut le seul musée à rester ouvert tout du long de la guerre : « Nelly a télégraphié de Grenoble qu’elle a réussi avec Farcy », nota Sophie Taeuber-Arp dans son journal le 13 septembre2. Malgré leur envie à tous et toutes, il semble que la collection n’ait finalement pas été exposée, mais qu’elle y ait rejoint les œuvres de Baumeister, Grosz ou encore Klee alors remisées dans une salle divisée par un rideau qui en défendait l’accès. Les caisses brièvement ouvertes pour inventaire puis refermées restèrent là jusqu’à la fin de l’hiver 1941, puis partirent de Marseille pour les États-Unis le 4 mars, sous un faux nom, et, comme biens de consommation courante, sur le conseil des transporteurs Lefebvre-Fointet qui organisèrent le subterfuge. Peggy Guggenheim qui croisait les doigts sur le quai en les voyant partir arriva elle-même à New York en juin.
Nelly van Doesburg resta dans la région de Grenoble où elle semble avoir été intermédiaire avec Farcy dans un commerce d’œuvres d’art dont on sait très peu, en l’état actuel des connaissances3. Farcy pour sa part fut arrêté le 14 septembre 1943 par la Gestapo puis interné au stalag de Compiègne (seul stalag en France) jusqu’à la libération du camp. « J’ai pu lire, écrira-t-il, au fichier du camp les raisons de mon internement : ‘‘exposition et propagande par expositions officielles du musée de Grenoble, d’œuvres d’art dégénéré’’ (…) il n’y avait rien à me faire avouer, puisque mon crime s’étalait sur les murs du musée. » Rien ne permet de corroborer sa version, puisqu’un tel fichier ne semble pas avoir existé à Compiègne, mais rien ne permet non plus de l’infirmer4.
Il y a ceux qui partent, et il y a ceux qui restent. II y a les Arp qui laissèrent par deux fois expirer leurs visas pour les Etats-Unis parce qu’ils ne pouvaient payer le passage de leurs œuvres sur le bateau, et arriver « pauvres comme Job », et « recommencer la lutte encore une fois !5 » Il y a Sophie Taeuber-Arp qui mourut en janvier 1943 en Suisse où ils n’avaient pas le droit de rester, et Jean Arp qui s’effondrait, ses amis lui permettant de ne pas revenir en France. Il y a Sonia Delaunay qui, en proie aux privations, Juive selon la législation antisémite en vigueur, veilla comme une mère sur ses petits sur les caisses d’œuvres que le couple avait laissées dans le Sud fin 1942 ; c’est à elle, assurément, qu’on doit leur survie. Il y a Nelly van Doesburg qui se réveillera pendant des années en sursaut, quand lui reviendront ces moments où elle avait failli mourir de froid, avec Farcy à son chevet, dans sa petite chambre d’hôtel à Grenoble, et que la police frappait à la porte en pleine nuit6. Il y a Kandinsky qui ne sortait plus guère à Neuilly mais à qui la galerie Jeanne Bucher organisa en 1942 une petite exposition dans la clandestinité, puis à nouveau une rétrospective en 1944. Il y a Raoul Hausmann qui partit se cacher dans les bois et brûla le carton contenant les rares revues dadas qui lui restaient quand la division SS Das Reich passa en 1944 à côté du petit village où l’exode l’avait conduit en Limousin. Il y a Hannah Höch, la seule dadaïste à être restée en Allemagne, qui enterrait la nuit, sans s’éclairer, dans le jardin de sa maison à la périphérie de Berlin, des cantines métalliques contenant des œuvres de Schwitters, celles de Hausmann (dont la Tête mécanique qui est aujourd’hui conservée au Musée national d’art moderne, à Paris), les siennes propres. Il y a des objets et des tableaux qui traversent la guerre sous terre, d’autres qui voguent sur les mers, d’autres qu’on remballe vite, d’autres qui périssent. Leur histoire et celle de leurs caisses anodines sont au cœur des destins de leurs créateurs, comme de la fabrication et de la survie de l’idée même d’avant-garde.