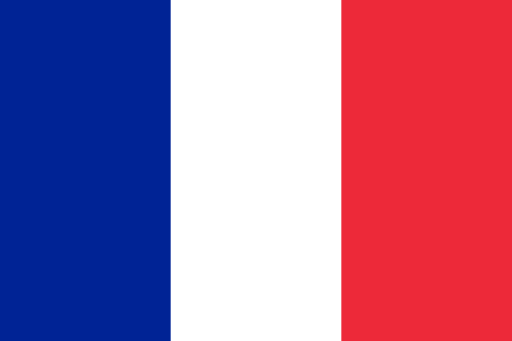La restitution des biens juifs spoliés sous l’Occupation. Une approche sociale et culturelle
En France, la spoliation des biens des personnes considérées comme juives du temps de l’Occupation a duré quatre ans, et pourtant, quatre-vingts ans plus tard, une « Commission d’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation » (CIVS) travaille activement. Que s’est-il donc passé dans l’intervalle ? Après que la République française a mené une politique de restitution de 1944 à 1954, complétée de 1957 aux années 1970 par une politique fédérale allemande, le dossier des restitutions a paru clos. Il a cependant ressurgi dans les années 1990. Dans le double contexte de la fin de la guerre froide et de la nouvelle centralité du génocide des Juifs dans la perception de la Deuxième Guerre mondiale, le triangle de forces constitué par la politique publique, la demande sociale et le rapport au passé s’est trouvé transformé.
Un premier cycle de restitutions : français (1944-1954) puis allemand (1957-années 1970)
Dans ce premier cycle, le moteur des restitutions ne fut pas la pression qu’aurait pu exercer une mémoire unifiée et partagée du génocide, mais la présence des spoliés et d’une politique publique.
Pour la République, il s’agissait de rétablir dans leurs droits ceux qui avaient été discriminés et persécutés en vertu d’une idéologie antidémocratique. Il fallait aussi restaurer le caractère laïque d’une République qui ne connaissait que des « hommes » et des « citoyens », « sans distinction de race, de religion ni de croyance ». Mis à part la grande ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine, qui constatait la « nullité de tous actes » établissant « une discrimination quelconque sur la qualité de Juif », le terme même de « Juif » fut ainsi banni des textes de restitution. Cela n’empêchait pas que la conscience du génocide fût vive, mais elle passait au second plan, derrière les événements politiques et militaires de la guerre mondiale.
Même au sein de la population qui sortait de la persécution, la mémoire du génocide n’était pas uniforme. La société juive – si l’on peut employer cette approche globalisante – était divisée et segmentée sur un arc étendu qui partait de la position légaliste – sous l’Occupation – du Consistoire et de l’UGIF (Union générale des israélites de France, création allemande et vichyste), et allait jusqu’au parti communiste clandestin avec l’UJRE (Union des Juifs pour la résistance et l’entraide), en passant par la position laïque et libérale, sur le mode de 1789, du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) créé dans la clandestinité en 1943. Même la réunion de ces tendances au sein du CDJC puis du CRIF (Conseil représentatif des israélites – puis des Juifs – de France), au début de 1944, n’avait pas fait disparaître les tensions. Le Consistoire, par exemple, s’était opposé à ce que le CRIF lance un appel à la Résistance.
En dépit de la diversité des mémoires et des cultures, l’accord entre les différentes composantes de la société juive se faisait sur la volonté de retour à la normale, c’est-à-dire à la situation d’avant-guerre. La persécution nazie et vichyste n’a pas eu pour conséquence immédiate la remise en cause de l’assimilationnisme républicain. Nombre d’anciens persécutés demandèrent à changer de patronyme pour adopter un nom moins situé, et, dans les synagogues, les morts en déportation étaient souvent qualifiés de « morts pour la France » sur le modèle des soldats morts au front. Cependant, la conscience de la spécificité du génocide s’accentua avec le temps.
Dans l’après-guerre, la demande sociale de restitution fut forte du nombre de survivants (environ les trois quarts de la population persécutée). Elle était forte aussi de son bon droit. L’illégitimité des spoliations ne faisant pas de doute, de nombreuses restitutions eurent lieu à l’amiable. Quand des résistances se manifestaient, des démarches auprès des services concernés s’efforçaient de les réduire. Dans les semaines qui suivirent la Libération, ce fut le cas avec les interventions de l’UJRE à Marseille et à Paris, du Service des restitutions du professeur Terroine à Lyon, et du gouvernement en décembre 1944, qui fit modifier le droit des associations pour interdire des groupements tendant « à faire échec au rétablissement de la légalité républicaine ». Mais le sujet ne suscita pas de campagne de presse. En 1950, quand le processus de restitution marqua le pas faute de demandes, une loi ouvrit la possibilité pour les organisations juives de prendre en main la gestion des biens en déshérence. Cette disposition resta sans suite.
Du côté de l’État, la politique de restitution conduite dans l’après-guerre reposa sur le même paradoxe (la non-reconnaissance d’une identité juive) et la même détermination à rétablir dans leurs droits les victimes de spoliation. On sait que dès 1940, le général de Gaulle avait déclaré nulle et non avenue la politique antisémite de Vichy. En 1943, la France libre a signé la déclaration solennelle du 5 janvier par laquelle les Nations unies se réservaient le « droit de déclarer non valables tous transferts ou transactions relatifs à la propriété » dans les territoires occupés. La mise en œuvre de la politique de restitution débuta lentement, à Alger (ordonnances du 14 mars et du 12 novembre 1943), puis se généralisa avec la libération du territoire métropolitain. Les mesures se succédèrent : déblocage immédiat des comptes bancaires en août 1944, ordonnance de restitution des biens placés sous le séquestre des Domaines (octobre), ordonnance de restitution des biens sous administration provisoire (novembre), création de la Commission de récupération artistique (CRA, en novembre aussi), réactivation de l’OBIP (Office des biens et intérêts privés, créé pendant la Première Guerre mondiale) chargé de recevoir les déclarations d’enlèvement par l’ennemi (décembre), création du Service des restitutions des biens des victimes des lois et mesures de spoliation (janvier 1945), ordonnance de restitution des biens vendus de force (avril 1945), loi sur les dommages de guerre (qui incluait l’indemnisation des pillages d’appartement, octobre 1946), loi de remboursement des prélèvements opérés sur les comptes bloqués (juin 1948), et création d’une Commission de choix des œuvres d’art récupérées et ne pouvant être restituées (en juin 1948 également).
Au début des années cinquante, le cycle des restitutions françaises paraissait clos, même si tous les propriétaires n’avaient pas retrouvé leurs biens (l’OBIP avait reçu la réclamation de quelque 100 000 biens « enlevés par l’ennemi »), et si certains biens n’avaient pas retrouvé leur propriétaire. Les objets et œuvres d’art récupérés en Allemagne étaient au nombre de 60 000, mais 15 000 environ ne trouvèrent pas de propriétaire. La Commission de choix en sélectionna près de 2 000 qui furent d’abord exposés pendant trois ans (1950-1954) au château de Compiègne, puis, en l’absence de revendication, placés dans les musées avec le statut MNR (Musées nationaux Récupération) ou OAR (Objet d’art Récupération). Le reste fut vendu au profit de l’État par les Domaines.
En France, il n’y eut presque pas de débat public sur les restitutions. Ce fut différent en Allemagne, où les lois successives d’indemnisation des biens pillés dans les pays occupés suscitèrent des résistances et de vifs débats au Bundestag. Sur intervention diplomatique et par étapes successives, en 1957, 1961 et 1964, la loi dite BRüG (Bundesrückerstattungsgesetz) ouvrit progressivement la possibilité pour les spoliés, notamment les victimes du pillage d’appartements, de recevoir une indemnisation. Le Fonds social juif unifié (FSJU) prit en main l’essentiel de la gestion des dossiers de réclamation. Les indemnités venaient en complément des dommages de guerre déjà perçus, mais pour les œuvres et objets d’art, c’était la première possibilité d’indemnisation car, en France, les dommages de guerre n’avaient pas pris en compte les biens somptuaires.
Avec l’achèvement de la voie allemande dans les années 1970, le cycle des restitutions parut terminé. Le Rapport général de la mission Mattéoli (voir infra) a estimé que la spoliation restante représentait entre 5 % et 10 % en valeur de la spoliation comptabilisable totale et autour de 25 % des propriétaires. En revanche, les pillages proprement dits, non comptabilisés et rarement listés à l’époque, n’ont vraisemblablement pas atteint le même taux de restitution, en dépit de l’action des Alliés en Allemagne et des indemnisations fédérales ultérieures. Or les œuvres d’art étaient particulièrement concernées par ces pillages.
Le deuxième cycle : des réparations médiatisées dans un monde globalisé, 1995-…
Le fait qu’une politique de restitution conduite dans les conditions de l’époque, de manière imparfaite mais néanmoins déterminée, fasse l’objet d’une reprise, plus de vingt ans après son achèvement, pourrait surprendre. Ce rebond vient de la convergence d’un changement culturel et d’un nouveau rapport de force international.
Dans les années 1990, le passé n’est plus ce qu’il était dans les années cinquante. La conscience du génocide, qui n’avait à aucun moment disparu, est devenue un fait majeur, généralement et publiquement partagé. Le récit national des années de guerre, qui était plutôt centré sur les combats ou sur la Résistance et la Collaboration, se focalise sur les victimes, au premier rang desquelles figurent ceux qu’on peut appeler désormais les Juifs, sans que ce terme ne comporte une connotation particulière. L’origine de ce déplacement de focale est multiple, mais il tient notamment à la multiplication des travaux historiques tels ceux de Serge Klarsfeld. Le procès Eichmann et la guerre des Six Jours ont aussi joué un rôle, de même que les événements de Mai 68. C’est en 1968 que Beate Klarsfeld gifle le chancelier allemand Kurt Georg Kiesinger, un ancien dignitaire nazi, actif auprès de Ribbentrop. On résume souvent ce phénomène générationnel d’une formule : le paradigme de la victime aurait remplacé celui du héros combattant.
En France, la transformation culturelle et générationnelle apparaît de manière particulièrement saisissante par la manière dont le président Mitterrand l’ignore. Fleurissant chaque année la tombe du maréchal Pétain, « vainqueur de Verdun », et refusant de reconnaître la responsabilité de la France dans la Shoah, il rencontre une incompréhension croissante. En 1995, c’est le nouveau président, Jacques Chirac, qui reconnaît, lors de l’anniversaire de la rafle du Vel’ d’Hiv’, que « Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français […] la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable ».
Parallèlement à cette évolution, les relations internationales se trouvent transformées à leur tour par la chute du mur de Berlin. Dans les ex-pays de l’Est ou à leur propos, les « doubles victimes » se font entendre, celles qui ont été victimes de « l’aryanisation » nazie suivie de l’étatisation communiste. Par ailleurs, jusque-là contenues par la guerre froide, les tensions entre les États-Unis et l’Europe se déploient librement. Une vision du passé conçue sur le modèle de la Pologne occupée tend à s’imposer depuis l’Amérique du Nord, révélant l’ampleur du « gap » culturel transatlantique creusé depuis 1945. Dans ce schéma de pensée, tous les Juifs ont été spoliés, déportés sans retour et jamais indemnisés. À partir de 1995, les médias français s’emparent du sujet et dénoncent à travers les MNR la présence d’œuvres d’art volées aux Juifs dans les musées français. Les biens en déshérence dont on pense qu’ils sont restés dans les banques font aussi l’objet d’articles indignés. Dans ce contexte, la politique publique paraît suivre la demande plutôt qu’elle ne la précède. Au début de 1997, une mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, dite mission Mattéoli du nom de son président, est créée afin d’évaluer le montant des biens susceptibles d’être restés en déshérence dans les administrations et les entreprises.
La focalisation de la presse sur les œuvres d’art et les comptes en banque fait écho aux actions entreprises outre-Atlantique, notamment au moyen de « class actions » menaçant d’interdiction sur le sol américain l’activité d’entreprises d’origine européenne. Les banques suisses sont visées par ce moyen en octobre 1996, puis les établissements français en décembre 1997 et décembre 1998. Quant aux œuvres d’art, elles font l’objet d’une conférence internationale tenue en décembre 1998 également, suscitée par le Congrès juif mondial (WJC) avec l’appui du gouvernement américain. Le président du WJC y qualifie les œuvres d’art spoliées de « derniers prisonniers de guerre ». Les pays participants, dont la France, s’engagent à respecter ces nouveaux « principes de Washington » en se donnant les moyens d’aboutir à une « solution juste et équitable » concernant les œuvres confisquées par les nazis et non restituées à leurs propriétaires.
En 2001, le montant estimé par la mission Mattéoli des biens en déshérence est versé à une Fondation pour la mémoire de la Shoah créée à cet effet. Sur les recommandations de la mission, le dossier des indemnisations individuelles est rouvert par ailleurs, avec la création en 1999 de la CIVS mentionnée plus haut. En ce qui concerne les œuvres d’art, la résistance de la sphère des musées n’a pas permis d’évaluer les MNR, mais le monde de la culture s’engage lentement sur la voie des recherches de provenance. Une mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 a été créée au sein du ministère de la Culture en 2019, et la CIVS continue d’examiner les requêtes des descendants. Quant aux avoirs bancaires non réclamés, la France et les États-Unis ont convenu d’une méthode d’indemnisation qui combine les critères français (étude préalable des faits) et américains (attribution d’une somme forfaitaire).
En 2022, ce deuxième cycle de réparation semble arriver à son terme. Après avoir connu un pic au début des années 2000, le nombre de requêtes – tous biens confondus – adressées à la CIVS diminue régulièrement. Parmi les 30 000 requêtes reçues en vingt années d’existence, les deux tiers ont porté sur les pillages d’appartements et la spoliation de biens professionnels, et le tiers restant sur les spoliations bancaires. Cependant, les requêtes visant des biens culturels mobiliers deviennent plus fréquentes. Depuis 2018, des dispositions législatives et réglementaires nouvelles en ont facilité la prise en compte1. Ce sont ces derniers dossiers qui retiennent aujourd’hui l’attention des médias, en raison de la valeur symbolique des œuvres d’art, mais aussi du fait de l’évolution du marché de l’art.
Bibliographie
Andrieu, Claire, « En France, deux cycles de politique publique : restitutions (1944-1980) et réparations (1997-…) », in Constantin Goschler, Philipp Ther et Claire Andrieu (dir.), Spoliations et restitutions des biens juifs en Europe, Paris, Autrement, 2007.
Andrieu, Claire, avec la collaboration de Cécile Omnès et al., La Spoliation financière, rapport, Paris, La Documentation française, Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, 2000, tomes I et II.
Azouvi, François, Le mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire, Paris, Fayard, 2012.
Bouchoux, Corinne, « Si les tableaux pouvaient parler… » Le traitement politique et médiatique des retours d’œuvres d’art pillées et spoliées par les nazis (France, 1945-2008), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.
CIVS, Commission d’indemnisation des victimes de spoliations, Rapports d’activité en ligne sur son site : www.civs.gouv.fr
Eizenstat, Stuart E., Une justice tardive. Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Seuil, 2004.
Ghiles-Meilhac, Samuel, Le CRIF. De la Résistance juive à la tentation du lobby, de 1943 à nos jours, Paris, Robert Laffont, 2011.
Lazare, Lucien, La Résistance juive en France, Paris, Stock, 1987.
Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, Rapport général, Paris, La Documentation française, 2000.
Perego, Simon, Pleurons-les : les Juifs de Paris et la commémoration de la Shoah, 1944-1967, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2020.
Wieviorka, Annette, Déportation et génocide : entre la mémoire et l’oubli, Paris, Hachette, 1995.
Séminaire "Patrimoine spolié" : Restitution des biens culturels en France, de 1944 aux années 1990
Simon Perego et Claire Andrieu - 9 décembre 2021
Données structurées
Personne / personne